

« Hegel en France »
Séminaire 2012
Responsable : Philippe Sabot (Lille3/STL)






Alain Bataille Queneau Sartre Deleuze Althusser
Ce séminaire se fixe comme objectif de contribuer à une histoire de l’hégélianisme à la française, pour la période qui s’étend de 1830 à 1950 environ. Lors des séances de l’année 2010, il s’agissait notamment faire apparaître les conditions dans lesquelles a pu s’effectuer le transfert, du côté de la littérature, d’une pensée comme celle de Hegel. Car un tel transfert a eu lieu en France de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’à l’entre-deux guerres, c’est-à-dire à un moment où l’hégélianisme s’est trouvé à peu près complètement délaissé par l’institution philosophique et a pu être librement investi et accueilli par les écrivains, suivant des modalités d’ailleurs très variables. Le séminaire de l’année dernière a pu prolonger ce travail collectif en insistant sur la variété des usages et des appropriations de Hegel non seulement chez des écrivains comme Mallarmé, Aragon, Breton, mais aussi chez des penseurs comme Proudhon, Wahl, Kojève, Hyppolite ou Eric Weil. Nous avons ainsi vu se dessiner au fil des séances du séminaire les différents visages de cet « hégélianisme » qui a fini par intégrer nos cursus scolaires et universitaires mais dont il est utile aussi de mettre en lumière la constitution historique.
Cette recherche sur les différentes formes prises par la réception de la pensée hégélienne en France depuis le XIXe siècle, se poursuivra cette année à partir d’ interventions consacrées à aux reprises et aux réappropriations originales de Hegel dans la philosophie (Alain, Koyré, Sartre, Althusser, Deleuze) et dans la littérature (Bataille, Queneau) au XXe siècle.
Les séances auront lieu le lundi, de 14h à 16h, en salle D. Corbin (UMR STL)
Programme des premières séances
30 janvier 2012. - Philippe Sabot (Lille 3/STL) :
« Alain et les idées de Hegel »
20 février 2012. - Philippe Sabot (Lille 3/STL) :
« Le désir et l’Histoire : Bataille et Queneau lecteurs de Kojève »
19 mars 2012. - Andrea Bellantone (Faculté catholique de Paris/Université de Turin) :
« Le défi de l'éternel et du temps. Koyré lecteur de Hegel »
16 avril 2012. - Vincent de Coorebyter (Bruxelles):
« Le Hegel de Sartre »
Groupe de travail
« Avec Foucault »
Responsable : Philippe Sabot (Lille 3/STL)
Les séances du groupe de travail "Avec Foucault" auront lieu le mercredi, de 15h à 17h à Lille 3 (salle à préciser).
Ce groupe de travail se propose de créer un espace de réflexion collective à partir de présentation de travaux ou de recherches en cours consacrés à la pensée de Michel Foucault ou utilisant certains outils conceptuels de Foucault pour penser des objets et des situations contemporaines.
Les séances du groupe de travail seront consacrées à un exposé (45mn environ) suivi d'une large discussion.
Tous les étudiants sont les bienvenus !
Programme des séances
25 janvier 2012. - Philippe Sabot (Lille 3/STL) :
« Avec Foucault… »
8 février. – Karine Bocquet (Lille3/STL) :
« Foucault versus Bourdieu, ou comment le pouvoir vient aux hommes »
22 février. - Damien Cassette (Lille 3) :
« Technologie et dispositif : le problème des effets réels de la vérité »
7 mars. - Julien Delcourt (Lille 3) :
« Pouvoir et résistances : Foucault avec Althusser ».
21 mars. – Grégory Salle (Lille 1/CLERSE) :
« Avec Foucault, sur la piste d'une généalogie de l' « État de droit » »
18 avril. – Stéphane Zygart (Lille 3/STL) :
« A propos des Anormaux ».
16 mai.- Ivan Ponton (Lille 3/STL ) :
« Foucault et Œdipe-Roi »
30 mai.- Lucien Vinciguerra (Lille 3/STL) :
« Foucault et les mathématiques »
Lectures de Baudelaire (1)
S’il est pertinent d’opposer ou du moins de distinguer, ainsi que Pierre Macherey l’a proposé , le fait d’être moderne, c’est-à-dire le fait d’appartenir à une époque historique déterminée sur le mode d’une condition temporelle passivement subie, et la conscience de modernité comme l’effet d’une disposition active de l’homme moderne qui le conduit à interroger son mode d’être en vue d’en extraire une analyse ou une interprétation de sa propre identité présente, alors il faut bien admettre que l’œuvre de Charles Baudelaire se situe du côté de cette seconde catégorie dans la mesure où elle s’attache précisément à circonscrire les conditions de constitution de la modernité en l’expérimentant aussi bien sur le plan “théorique” de la réflexion critique (dans les Salons et autres essais esthétiques) que sur le plan directement poétique de son élaboration et de ses expressions littéraires (dans Les Fleurs du Mal ou les Petits poèmes en prose). D’ailleurs, Baudelaire n’est-il pas l’inventeur du mot même de “modernité” dont il risque la formulation en 1859 dans “Le peintre de la vie moderne” en en faisant véritablement le mot d’ordre et le dénominateur commun d’une esthétique et d’une poétique nouvelles , centrées sur une prise de conscience sans précédent du rapport apparemment contradictoire entre la beauté et la dimension du présent. Un tel rapport est particulièrement explicité dans les célèbres déclarations, à valeur d’injonctions programmatiques dont Baudelaire émaille son essai sur Constantin Guys :
Le plaisir que nous retirons de la représentation du présent tient non seulement à la beauté dont il peut être revêtu, mais aussi à sa qualité essentielle de présent .
Ou encore :
Cet élément transitoire, fugitif, dont les métamorphoses sont si fréquentes, vous n’avez pas le droit de le mépriser ou de vous en passer .
Autrement dit, la modernité correspond selon Baudelaire à un nouvel impératif artistique qui consiste à soumettre l’exigence traditionnelle de la beauté à celle d’une “représentation du présent” en tant que tel. Le beau, qui était la clef de voûte de l’esthétique classique, devient donc l’effet de la constitution de l’œuvre d’art moderne qui se signale avant tout par sa capacité à saisir dans le trait d’un dessin ou dans le rythme d’un vers ce qu’il y a de “transitoire” et de “fugitif” dans le présent et qui constitue, de manière paradoxale, l’essence même de ce présent. Dans ces conditions, l’artiste est logiquement haussé au rang de véritable héros de la vie moderne dans la mesure où, au lieu d’être simplement pris dans les fréquentes métamorphoses de la réalité, et de s’y complaire passivement, il cherche à les “représenter” activement, donc à s’en écarter suffisamment pour parvenir à révéler la beauté originale que de telles métamorphoses peuvent receler intrinsèquement, – cette beauté “bizarre”, qui échappe au premier regard tout autant qu’elle s’écarte des canons figés de la beauté classique, pour “satisfaire aux exigences d’un idéal de nouveauté sans cesse renouvelé” . L’esthétique moderne, comme esthétique de la modernité, s’alimente donc à cette tension, repérée et exploitée par Baudelaire avec une lucidité particulière, entre l’idéal et le nouveau, entre l’intemporel et le présent. Cela signifie aussi que la poétique de la modernité procède d’une esthétisation du quotidien, dans la mesure où elle prend appui sur le phénomène de la mode, c’est-à-dire le phénomène d’une nouveauté sans cesse en voie de péremption, pour appréhender non seulement sa modernité, sa “qualité essentielle de présent”, mais la beauté propre à cette évanescence du présent, sa valeur proprement esthétique qui hausse le phénomène jusqu’à sa propre essence. L’art du poète ou du peintre de la vie moderne consiste ainsi dans une expérience complexe qui combine la conscience historique du présent et la conscience esthétique du beau :
La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable .
L’œuvre d’art moderne se distingue par conséquent de l’œuvre d’art classique et romantique en ce qu’au lieu de se perdre “dans le vide d’une beauté abstraite et indéfinissable, comme celle de l’unique femme avant le premier péché” , elle se forme à partir d’une beauté concrète, déterminée, conquise à même ces éléments fuyants, produits par et dans le mouvement quotidien de l’histoire, et qui lui assurent sa valeur proprement esthétique. Si “le beau est toujours bizarre” , c’est justement qu’il ne procède pas d’une épuration idéalisante ou universalisante du réel contingent, négligé ou embelli selon une procédure d’abstraction qui vaudrait comme une pratique de dénégation, mais qu’il exprime désormais l’universalité et la nécessité du contingent lui-même, c’est-à-dire son irréductibilité. Ève doit désormais sa beauté à sa chute dans un monde moderne, – monde profane et quotidien. De cette manière, la modernité poétique et esthétique dont Baudelaire dessine les contours n’est nullement “une variante tardive de l’antithèse platonicienne et chrétienne entre le temps et l’éternité, dont le romantisme encore avait usé et abusé” . Car, plutôt que de se fonder sur la résolution de ces contradictions comme dans le platonisme de l’esthétique classique qui en escamote l’un des termes au profit de l’autre, elle explore plutôt la tension dialectique qui les anime et qui anime le présent et le réel eux-mêmes, – tension dont la formule de Rimbaud “Il faut être absolument moderne” manifeste encore l’exigence paradoxale.
La poétique de la modernité dont Baudelaire se fait le héraut prend de cette manière une double signification : elle implique d’abord qu’il y a du poétique dans la modernité, et ce poétique est ce qui soustrait le transitoire de la mode à sa facticité en lui donnant un sens et une valeur proprement esthétiques ; mais il y a aussi une poétique de la modernité au sens où la vie moderne elle-même est reconnue, envisagée comme le terrain privilégié d’exploration et d’ajustement de formes poétiques nouvelles, susceptibles de répondre aux exigences particulières de l’expérience moderne : les poèmes en prose élaborent ainsi une forme langagière inédite, à la fois “assez souple” et “assez heurtée” (selon les termes mêmes de Baudelaire ) pour répondre aussi bien aux mouvements lyriques de l’âme (et à sa vocation poétique) qu’aux chocs soudains subis par la conscience au contact de la grande ville et de ses incessantes métamorphoses.
C’est d’ailleurs sans doute parce qu’elle s’accompagne d’une réflexion approfondie sur les conditions matérielles et formelles de sa propre pratique poétique que l’œuvre de Baudelaire marque un tournant ou une rupture décisives, et qu’elle reçoit même le statut d’une véritable “origine”, à laquelle devrait donc être reconduit l’ensemble du travail poétique mené depuis elle, c’est-à-dire aussi d’une certaine manière à partir d’elle. Quoi qu’il en soit de cette assignation rétrospective de la modernité poétique de Baudelaire au rang mythique d’une origine, il est clair en tout cas qu’avec son œuvre s’opère, à vif, un véritable diagnostic de la modernité, d’autant plus intéressant ou stimulant d’ailleurs qu’il concerne aussi bien ses aspects strictement esthétiques et littéraires (avec le changement de paradigme esthétique qui conduit à une réévaluation de la nature du beau et avec le réaménagement des principes formels de l’écriture et du “style” poétiques) que ses aspects socio-politiques – dans la mesure où l’artiste n’est plus exclu du monde social et en rapport direct avec l’absolu, mais plongé dans la foule de ses semblables, au cœur de la réalité quotidienne et urbaine, pour en extraire la vérité poétique. Il n’est pas étonnant alors que l’œuvre de Baudelaire, avec ses multiples dimensions, ait été si mal comprise, si décriée par ses contemporains, et qu’elle ait aussi suscité autant d’intérêt chez les écrivains ou philosophes qui, avec un certain recul, se sont fixés pour tâche d’esquisser à leur tour les contours et d’explorer les différentes facettes d’une modernité en crise, par définition instable, dont les formes mouvantes méritent par conséquent d’être sans cesse repensées.
C’est dans cette perspective manifestement que Walter Benjamin, dans les textes écrits à la fin des années trente et rassemblés dans le volume intitulé Charles Baudelaire. Un poète lyrique à l’apogée du capitalisme et Michel Foucault, dans les quelques pages qu’il consacre au “Peintre de la vie moderne” dans la conférence américaine de 1984 sur “Qu’est-ce que les Lumières ?” se sont attachés à situer l’œuvre, la pensée et la vie de Baudelaire, élevées pour l’occasion au rang de symptômes d’une attitude de modernité dont ils proposent de faire à nouveau le diagnostic en vue de réactiver une démarche d’analyse critique du présent. Entre ces deux études, clairement orientées vers la question de la modernité, on peut se demander alors quel sort il convient de réserver à la longue introduction que Jean-Paul Sartre a consacrée en 1947 aux Écrits intimes de Baudelaire où l’interrogation se déplace clairement du côté d’une analyse existentielle, cherchant à remonter des confidences les plus personnelles de Baudelaire à ses proches jusqu’au choix fondamental d’être poète qui anime et oriente toutes ses conduites, sur le plan personnel comme sur le plan poétique. En quoi le Baudelaire de Sartre, qui focalise donc l’attention sur la personnalité du poète, peut-il encore concerner une interrogation sur la modernité ? Cette question ne peut à notre avis être résolue qu’en repartant des analyses de Benjamin dont Sartre et Foucault offrent chacun à leur manière (et sans doute pour une large part à leur insu) un prolongement original, qui définit des prises de position opposées sur le thème et les usages de la modernité. Par conséquent, plutôt que de procéder à la simple juxtaposition des lectures de Baudelaire qu’ont pu proposer Benjamin, Sartre et Foucault , il paraît plus judicieux de procéder à leur confrontation en tentant de clarifier par là l’intérêt ou le désintérêt que ces trois penseurs portent, à travers la figure paradigmatique de Baudelaire et à travers le prisme de son œuvre, à la question de la modernité et plus précisément au thème général, et ambigu, de sa crise ou de sa “critique”.
Essayons donc d’abord de comprendre en quoi l’expérience poétique et l’ensemble de la réflexion esthétique et critique de Baudelaire prennent une place tout à fait privilégiée dans l’archéologie de la modernité que propose Benjamin dans ce livre inachevé intitulé Charles Baudelaire . De fait, le projet même du livre sur Baudelaire paraît indissociable de cet autre grand projet intitulé Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des Passages, dont Benjamin confie à Horkheimer que le premier en est comme le “modèle-miniature” . En effet, le Passagenwerk se présente comme une analyse des manifestations culturelles du capitalisme. Il s’agit donc de montrer “l’expression de l’économie dans la culture” , et tout particulièrement de montrer comment cette expression se laisse saisir sur le vif dans les “passages parisiens”, construits au début du XIXe siècle qui livraient aux regards émerveillés des passants les vitrines de magasins et de café, bénéficiant le soir des premiers éclairages au gaz. Ce travail à l’intersection de la sociologie et de l’analyse philosophique devait également permettre de cerner les effets produits par les aménagements urbains du Baron Haussmann sur les comportements des passants . On saisit alors un peu mieux de quelle manière la figure de Baudelaire, l’auteur des “Tableaux parisiens”, du Spleen de Paris et le traducteur deL’Homme des foules de Poe, a pu s’intégrer à un tel projet qui vise en un sens à analyser les formes nouvelles d’expérience induites par la modernité urbaine, tout particulièrement celle de Paris à partir du second Empire. D’une certaine façon, la poésie baudelairienne offre un témoignage saisissant de cette modernité. Mais en faisant de la grande ville un objet de poésie lyrique, elle participe aussi directement à l’émergence d’une esthétique de la foule dont Benjamin s’attache précisément à analyser les conditions de constitution.
Cette analyse tend à privilégier la figure du “flâneur”, figure coextensive aux métamorphoses de la grande ville qui forment l’espace mouvant où se cristallisent les fantasmagories propres à l’émergence de la société capitaliste moderne. Comment alors cette figure du flâneur vient-elle se superposer à celle du poète pour devenir l’emblême de l’homme moderne ? C’est que le poète occupe avant tout une position ambiguë dans laquelle se réfléchit la tension propre à l’expérience de la modernité : s’il cherche “un refuge dans la masse de la grande ville” , c’est pour s’isoler et se séparer d’elle au moment même où il la “coudoie” ; il est celui qui, dans ses déambulations, enregistre les métamorphoses de la physionomie urbaine, se fait le chroniqueur du nouveau rythme de la ville, de la culture de l’éphémère et du fugitif qui en forme l’expression, mais il est aussi celui qui sait percer à jour le pouvoir d’illusion et les impasses de cette fantasmagorie culturelle. Du coup, Benjamin souligne la distance imperceptible séparant la description que donne le poète du flâneur marchant dans la ville, au milieu de la foule des passants et des badauds, et “un trait significatif du véritable Baudelaire - c’est-à-dire de celui qui se consacre à son œuvre. Ce trait, c’est la distraction. Avec le flâneur le plaisir de voir célèbre son triomphe. Il peut se concentrer dans l’observation - cela donne le détective amateur ; il peut stagner dans le simple curieux - alors le flâneur est devenu un badaud. [Or] Les descriptions révélatrices de la grande ville ne sont le fait ni de l’un, ni de l’autre. Elles sont le fait de ceux qui ont traversé la grande ville en état d’absence, perdus dans leurs pensées ou leurs soucis” . Le poète est donc un flâneur d’un type particulier, un flâneur distrait qui est comme absent au spectacle urbain qui se déroule sous ses yeux et qui occupe les autres passants. Or, par un effet paradoxal de cette présence-absence, son regard plein d’“attention inattentive, involontaire”, atteint l’envers du décor, il recueille en quelque sorte le “négatif” de la ville dont il traverse les apparences pour en atteindre et en révéler l’essence même, – l’essence caduque et transitoire d’une réalité parfaitement contingente, qui tend à s’effacer derrière les gestes et les attitudes stéréotypés de la foule en mouvement. La distraction fait donc du poète un flâneur lucide, distinct des autres par cette “faculté de catalepsie” qui le rend particulièrement sensible à la beauté nouvelle qui peut surgir “des chocs et des conflits quotidiens de la civilisation” et du monde modernes.
C’est à partir de cette catégorie du “choc” que Benjamin, dans le volet central de son livre, reconstruit la figure de Baudelaire, comme poète moderne et poète héroïque de la modernité : “Baudelaire a situé l’expérience du choc au cœur de son travail d’artiste” . Or, cette expérience procède directement du “contact avec les masses qui habitent les grandes villes” . Car selon Benjamin, la circulation et les déplacements des individus dans les rues de la ville moderne se trouvent de plus en plus conditionnés par “une série de chocs et de heurts. Aux carrefours dangereux, les innervations se succèdent aussi vite que les étincelles d’une batterie. […] L’homme d’aujourd’hui regarde autour de lui pour s’orienter parmi les signaux de la circulation. Ainsi la technique a soumis le sensorium humain à un complexe d’entraînement” . La ville associe ainsi la sauvagerie de ces heurts successifs à la forme disciplinée de comportements mécanisés, de réflexes conditionnés. Ainsi que le note Edgar Allan Poe dans L’Homme des foules à propos de cette nouvelle forme d’expérience dont Baudelaire devait tirer toutes les conséquences poétiques : “Quand on heurtait [les passants], ils saluaient bien bas ceux qui les avaient heurtés” . L’analyse de Benjamin qui reprend et prolonge ici clairement certaines réflexions de Georg Simmel dans son essai “Métropoles et mentalités”, replace cette description de la foule et du “mécanisme social” (comme disait Valéry ) qu’elle incarne, dans une perspective plus large qui permet de mieux saisir le rapport de l’auteur des “Tableaux parisiens” à la modernité. En effet, il observe d’abord que l’expérience moderne de la foule étend ses effets disciplinaires à l’ensemble des domaines de la vie culturelle et sociale : ainsi les collisions des passants sur le boulevard trouvent leur corrélat dans “le déclic instantané du photographe” et préparent le cinématographe, où “la perception traumatisante a pris valeur de principe formel” ; de même “par la fréquentation de la machine, les travailleurs apprennent à «adapter leurs mouvements au mouvement continu et uniforme de l’automate» (Marx, Le Capital, trad fr., I, t.2 p.103)” . Le travail industriel, soumis à la pure répétition de gestes machinaux, de processus automatiques, est ainsi l’expression moderne de cette dégradation de l’expérience qui aboutit à plonger le travailleur, le spectateur de cinéma, mais aussi le joueur dans une sorte d’hébétude face à des chocs que leur conscience se contente d’absorber et d’incorporer passivement :
Le processus qui détermine, sur la chaîne d’usine, le rythme de la production, est à la base même du mode de réception propre aux spectateurs de cinéma .
Et un peu plus loin, développant encore cette chaîne d’équivalence, Benjamin écrit :
Les gestes que provoque chez le salarié industriel le processus automatique du travail se retrouvent aussi dans le jeu qui exige un rapide mouvement de la main pour déposer une mise sur le tapis ou pour jeter une carte. Ce qui est «saccade» dans le mouvement de la machine s’appelle «coup» dans le jeu de hasard. Si le geste du travailleur qui actionne la machine est sans lien avec le précédent, c’est justement parce qu’il n’en est rien de plus que la stricte répétition. Chaque mouvement est ainsi séparé de celui qui l’a précédé qu’un coup de hasard d’un autre coup. Aussi bien, la corvée du salarié est-elle, à sa manière, l’équivalent de celle du joueur. Les deux sont aussi vides de contenu .
Se dégage ainsi clairement une opposition entre deux formes d’expérience dont la dénivellation caractérise en propre l’émergence de la modernité – d’une modernité que Benjamin et Baudelaire ont en partage : à une expérience fondée sur la continuité d’une action dont les moments et les contenus sont interconnectés (comme dans le travail artisanal selon Marx) s’oppose en effet la discontinuité d’une expérience fondée sur le dressage des corps dans les à-coups d’une automatisation de l’activité humaine sous toutes ses formes :
Le choc en tant que forme prépondérante de la sensation se trouve accentué par le processus objectivisé et capitaliste du travail. La discontinuité des moments de choc trouve sa cause dans la discontinuité d’un travail devenu automatique, n’admettant plus l’expérience traditionnelle qui présidait au travail artisanal. Au choc éprouvé par celui qui flâne dans la foule correspond une expérience inédite : celle de l’ouvrier devant la machine .
Or, si la métamorphose de l’activité de travail, telle que l’a analysée Marx, paraît constituer à certains égards le paradigme commode de cette dénivellation moderne de l’expérience humaine (de sorte que Baudelaire peut légitimement être désigné comme “un poète lyrique à l’apogée du capitalisme”), c’est pourtant à partir d’une lecture d’Au-delà du principe de plaisir de Freud que Benjamin propose d’analyser les ressorts psychiques (et non plus seulement matériels) de cet appauvrissement généralisé de l’expérience dont la poésie de Baudelaire dresse héroïquement le constat. En effet, Freud part du principe selon lequel “la conscience naîtrait là où s’arrête la trace mnésique” . Par conséquent, la conscience ne contiendrait aucune trace mémorielle, mais sa fonction serait plutôt de protéger des sensations, de parer au choc en incorporant l’événement qui l’a provoqué à la conscience elle-même. C’est de cette manière, que, dans la grande ville, les expériences de choc finissent par engendrer l’indifférence et l’oubli :
A mesure que l’élément de choc se fait davantage sentir dans les impressions singulières, il faut que la conscience se défende de façon plus continue contre l’excitation ; mieux elle y réussit et moins les impressions particulières pénètrent dans l’expérience, mais plus important aussi devient, par là même, le rôle de l’expérience vécue .
Or, pour Benjamin, cette assimilation défensive des chocs par la conscience tend ni plus ni moins à “[stériliser] l’événement pour l’expérience poétique” et finalement à occulter, à refouler même, l’ “expérience” véritable (Erfahrung), celle qui procède des profondeurs de la mémoire, au profit d’une expérience vécue (Erlebnis) qui n’en est que la forme affaiblie ou amortie, discontinue . Cette occultation vise donc à parer l’impact traumatisant des sensations, à pallier ses effets à la fois uniformisants et aliénants qui sont au coeur de la vie moderne (puisqu’ils sont à l’œuvre partout dans la ville, dans la foule, dans les usines, dans les salles de jeux). Par contraste, le poète est le témoin privilégié de ce processus de dégradation généralisée de l’expérience , ce qui ne signifie sans doute pas qu’il y échappe, mais bien au contraire que sa poésie s’y enracine et s’en nourrit, comme d’une contradiction insoluble. Si “Baudelaire a situé l’expérience du choc au cœur de son travail d’artiste”, c’est bien que cette expérience le hante littéralement, et produit en lui une réaction poétique qui vaut comme une réaction post-traumatique : la “fantasque escrime” qui met le poète aux prises avec les ressources du langage est le combat qu’il mène contre l’engourdissement de sa conscience ; il pare les chocs en leur opposant “la parade de son être spirituel et physique” . Traumatophile davantage que traumatophobe , il cherche à “mesurer ce que signifie en réalité la catastrophe dont il était lui-même, en tant qu’homme moderne, le témoin” . La modernité de Baudelaire consiste donc à trouver les moyens poétiques de capturer “l’expérience catastrophique de la ville” , d’inventer les mots et le rythme capables d’exprimer la crise du monde moderne. Le poète est alors celui qui est capable de retourner la discontinuité de l’expérience vécue en principe poétique : “L’expérience du choc est de celles qui furent déterminantes pour la facture de Baudelaire” . Autant dire que la défense contre le choc prend l’allure d’un véritable combat qui ébranle les vers de Baudelaire, fait même défaillir leur métrique, et leur confère ainsi une irrégularité telle que parfois il semble que “le mot s’écroule sur lui-même” . Ainsi l’expérience du promeneur solitaire dans la foule vaut directement comme une expérience poétique au sens d’une mise à l’épreuve de la poésie et de ses possibilités expressives. C’est l’expérience vécue du choc qui doit fournir au poème non seulement sa matière mais aussi sa forme, quitte à renouveler en profondeur celle-ci pour l’ajuster aux impératifs de la conscience moderne. C’est dans cette perspective que Baudelaire lui-même présente à Arsène Houssaye le projet des poèmes en prose du Spleen de Paris :
Quel est celui d’entre nous qui n’a pas rêvé le miracle d’une prose poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s’adapter aux mouvements lyriques de l’âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience ? C’est surtout de la fréquentation des villes énormes, c’est du croisement de leurs innombrables rapports que naît cet idéal obsédant .
L’obsession de Baudelaire est donc de rendre compte, jusque dans le langage poétique, de l’image du choc qui procède de son contact avec la foule de la grande ville . Sa modernité poétique tient alors selon Benjamin à ce qu’il sait “le prix que l’homme moderne doit payer pour sa sensation : l’effondrement de l’aura dans l’expérience vécue du choc” . En effet, l’aura correspond à “l’apparition unique d’un lointain” , par essence inapprochable. Elle instaure entre un objet et le regard qui se porte sur lui une distance infranchissable, apte à faire surgir par le biais de la contemplation ou du culte une image idéale qui, par un singulier renversement de perspective, a le pouvoir de répondre (par une attention ou un regard) à celui qui la contemple :
L’expérience de l’aura repose donc sur le transfert, au niveau des rapports entre l’inanimé – ou la nature – et l’homme, d’une forme de réaction courante dans la société humaine. Dès qu’on est – ou qu’on se croit – regardé, on lève les yeux. Sentir l’aura d’une chose, c’est lui conférer le pouvoir de lever les yeux .
Or, à l’époque de la reproduction mécanisée de l’art, à l’époque où l’homme moderne est soumis dans sa vie quotidienne à des conduites automatisées à une proximité angoissante avec ses semblables, et à la multiplicité des chocs qu’engendre la grande ville, il n’y a plus aucune aura qui se fait sentir : il ne reste plus, au cœur de la foule, que des “yeux sans regard”, des yeux qui “ont perdu pour ainsi dire le pouvoir de regarder” . Baudelaire se présente de ce point de vue comme le poète du déclin de l’aura , et des formes d’expérience culturelle (le travail artisanal, l’exercice) et cultuelle qui lui était associées : il est la conscience vive, lucide et désespérée (spleenétique), de cet effondrement qui, au cœur du monde moderne, affecte toutes les dimensions de l’expérience humaine. Mais la rage de Baudelaire, sa “rogne”, se nourrit de son impuissance, et elle aboutit à faire de la “perte d’auréole” qu’il décrit lui-même dans la pièce en prose éponyme, le principe même d’une poétique du choc, de l’instantané, dont l’allégorie formerait en quelque sorte le ressort formel . En effet, comme le note Régine Robin, “à l’unité harmonique du symbole, à la totalité ou au fantasme de totalité qu’il déploie, Benjamin oppose dans l’allégorie, le règne du fragment amorphe, sans signification, l’histoire comme déclin, […] l’œuvre partielle dont la cohérence ne réside plus qu’en elle-même” . Le poète moderne se fait donc l’allégoricien d’un monde en crise, en ruines même, dont il cherche à capter la redoutable contingence, à saisir l’essence transitoire. Car si la réalité se donne désormais sous la forme de morceaux épars, de traces d’où toute aura s’est absentée, il ne reste plus au poète qu’à laisser son auréole “dans la fange du macadam” et à se faire “chiffonnier”, inlassable récupérateur et collectionneur dérisoire des fragments de la vie moderne :
Voici un homme chargé de ramasser les débris d’une journée de la capitale. Tout ce que la grande cité a rejeté, tout ce qu’elle a perdu, tout ce qu’elle a dédaigné, tout ce qu’elle a brisé, il le catalogue, il le collectionne. Il compulse les archives de la débauche, le capharnaüm des rebuts. Il fait un triage, un choix intelligent. Il ramasse comme un avare un trésor, les ordures qui, remâchées par la divinité de l’industrie, deviendront des objets d’utilité ou de jouissance .
L’“archéologie” de la modernité doit donc s’entendre ici comme cette activité laborieuse de collecte, de fouille, de bricolage des mots et des choses qui met au jour la part maudite de la vie moderne, et en extrait, par le biais d’une opération poétique, un or nouveau à l’éclat inconnu. A travers cette figure du chiffonnier, le poète apparaît comme celui qui retourne contre la modernité ses propres pouvoirs – ou sa propre impuissance : à l’appauvrissement de l’expérience qui résulte du contact avec les masses dans les grandes villes (ces masses ne produisent au fond que des déchets) répond en effet la tâche héroïque (parce que vouée à l’échec) d’assembler ou de bricoler des objets poétiques qui témoignent seulement de la puissance d’évocation d’une réalité en voie de fragmentation ou de détotalisation . Le beau est bizarre parce qu’il s’impose là où on ne l’attendait pas et parce qu’il oppose l’excentricité de l’allégorie et la charge concrète des mots de tous les jours, de la rue, aux images rassurantes et lisses de la “civilisation” et du “progrès” modernes.
Voir l’exposé de Pierre Macherey : « " Il faut être absolument moderne " : la modernité, état de fait ou impératif ? », disponible sur le site de l’U.M.R. “Savoirs, Textes, Langage” à l’adresse suivante : http://stl.recherche.univ-lille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/macherey20052006/macherey28092005cadreprincipal.html.
Ces deux plans d’expérimentation de la modernité sont clairement présentés dans le livre de Dominique Rincé,Baudelaire et la modernité poétique, Paris, PUF, “Que sais-je” n°2156, 1984.
Voir la mise en perspective proposée par H. R. Jauss dans son essai sur “La «modernité» dans la tradition littéraire”, inPour une esthétique de la réception, trad. fr., Paris, Gallimard, 1978. Selon Jauss qui suit ici le Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de P. Robert, c’est dans les Mémoires d’Outre-Tombe de Chateaubriand que se trouverait la plus ancienne occurrence du terme “modernité” (op. cit., p.158 et p.199, note 118).
Charles Baudelaire, “Le peintre de la vie moderne”, in Critique d’art, Paris, Armand Colin, “Bibliothèque de Cluny”, 1965, vol. 2, p.440.
Charles Baudelaire, “Exposition universelle de 1855. I. Méthode de critique”, in Critique d’art, vol. 1, p.189.
Walter Benjamin, Charles Baudelaire. Un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, trad. fr. J. Lacoste, Paris, Payot, 1982.
Michel Foucault, “What is Enlightment ?” [“Qu’est-ce que les Lumières ?”], in Dits et écrits, Paris, Gallimard, “Bibliothèque des sciences humaines”, 1994, IV, n°339 [1984], p.568-571.
Cette “introduction” de Jean-Paul Sartre est par la suite devenue un livre intitulé Baudelaire (Paris, Gallimard, 1947 ; “Folio/Essais”, 1988).
Il faudrait aussi faire une place aux analyses du poème en prose “La fausse monnaie” (Le Spleen de Paris, XXVIII) proposées par Jacques Derrida dans Donner le temps. 1. La fausse monnaie (Paris, Galilée, “La philosophie en effet”, 1991, chapitres 3 et 4).
Il faut rappeler que seuls trois textes du livre initialement projeté par Benjamin ont été écrits : Le Paris du second Empire chez Baudelaire (ce texte est lui-même composé de trois parties, à valeur d’analyse sociologique ou de critique sociale : “La bohême”, “Le flâneur” et “La modernité”) ; Sur quelques thèmes baudelairiens (qui comporte une suite argumentée de 12 paragraphes) et Zentralpark (qui reprend et prolonge, sous la forme de fragments, certains des thèmes présentés dans le texte central, dans lequel paraît en réalité se concentrer le propos philosophique de Benjamin).
Lettre à Horkheimer du 16 avril 1938, citée dans la préface de J. Lacoste à Charles Baudelaire, p.11.
Nous renvoyons ici aux analyses de Régine Robin dans “L’écriture flâneuse”, in Philippe Simay (dir.), Capitales de la modernité. Walter Benjamin et la ville, Paris-Tel Aviv, Editions de l’éclat, “Philosophie imaginaire”, 2005, p.37-54.
Comme le souligne Jean Lacoste dans l’une de ses précieuses notes, la notion de “fantasmagorie” est centrale dans la philosophie de l’histoire de Benjamin. Elle “vient de Marx et de l’analyse du fétichisme : dans le capitalisme le rapport social des hommes entre eux « prend la forme fantasmagorique d’un rapport entre les choses » (Das Kapital, Marx-Engels Werke, t 23, p.86 ; Le Capital, trad. fr. J. Roy, I, t. 1, Paris, Editions sociales, 1969, p.85). […] La fantasmagorie est une «illusion » (Poésie et révolution, trad. fr. M. de Gandillac, Paris, Denoël, “Les Lettres nouvelles”, 1971, p.137), une « transfiguration » qui détourne le regard de l’homme de la réalité et qui le distrait (Poésie et révolution, p.129), un « voile » (Poésie et révolution, p.133) et une « ivresse »” (Charles Baudelaire, p.260, note 7).
Sur la notion de “distraction”, voir Régine Robin, art. cit., p.43-45, où il est montré que Benjamin est ici très proche des analyses de Siegfried Kracauer (notamment dans “Culture de la distraction”, in Le voyage et la danse, Presses Universitaires de Vincennes, 1996).
Georg Simmel, “Métropoles et mentalité” ou “Les grandes villes et la vie de l’esprit” [Grossstädte und Geistigeslebens, 1903], repris dans Philosophie de la modernité, Paris, Payot, 1989. Sur le rapport entre Benjamin et Simmel, voir Graeme Gilloch, “Optique urbaine. Le film, la fantasmagorie et la ville chez Benjamin et Kracauer”, in Ph. Simay (dir.), Capitales de la modernité, p.111-113.
Ibid., p.183. Voir aussi dans les “Notes sur les Tableaux parisiens de Baudelaire” (1939), toujours à propos de L’Homme des foules de Poe, ce raccourci étonnant - et au fond assez discutable : “Ce passant dans une foule exposé à être bousculé par les gens qui se hâtent en tous sens, est une préfiguration du citoyen de nos jours quotidiennement bousculé par les nouvelles des journeaux et de la T.S.F. et exposé à une suite de chocs qui atteignent parfois les assises de son existence même. […] [Baudelaire] a bien senti la menace que les foules des grandes villes constituent pour l’individu et pour son aparté” (in Ecrits français, Paris, Gallimard, “Folio/Essais”, 1991, p.308-309).
Sigmund Freud, “Au-delà du principe de plaisir”, in Essais de psychanalyse, trad. fr. S. Jankélévitch, Paris, Payot, 1967, p.31 ; cité par Benjamin dans Charles Baudelaire, “Sur quelques thèmes baudelairiens”, p.156.
Dans son article sur “Le narrateur. Réflexions à propos de l’œuvre de Nicolas Leskov” (1936), Benjamin évoque dans le même sens la baisse du cours de l’expérience qu’il rapporte à l’impact de la grande guerre (cf. Écrits français, p.265).
Benjamin cite à plusieurs reprises la première strophe du “Soleil” de Baudelaire, où selon lui le poète présente une image de son propre travail poétique, important l’expérience du choc lié à la grande ville dans le langage lui-même :
“Le long du vieux faubourg, où pendent aux masures,
Les persiennes, abri des secrètes luxures,
Quand le soleil cruel frappe à traits redoublés
Sur la ville et les chmaps, sur les toits et le blés,
Je vais m’exercer seul à ma fanstasque escrime,
Flairant dans tous les coins les hasards de la rime,
Trébuchant sur les mots comme sur les pavés,
Heurtant parfais des vers depuis longtemps rêvés”
(Baudelaire, “Le Soleil”, in Les Fleurs du mal, “Tableaux parisiens”, XC ; cité par Benjamin notamment p.161).
Ibid., p.201. Benjamin critique de ce point de vue le daguerréotype qui forçait l’homme “à regarder (longuement d’ailleurs) un appareil qui recevait l’image de l’homme sans lui rendre son regard” (p.199).
Sur ce thème du “déclin de l’aura”, voir Peter Bürger, “Walter Benjamin : contribution à une théorie de la culture contemporaine”, in Revue d’esthétique, “Walter Benjamin”, Nouvelle série, n°1, 1981, p.25-27 ; voir aussi l’analyse de Jürgen Habermas, “L’actualité de Walter Benjamin. La critique : prise de conscience ou préservation”, Ibid., p.116-118.
Nous suivons ici les remarques de Peter Bürger dans “L’ « héroïsme de la vie moderne ». L’allégorie chez Baudelaire”,La Prose de la modernité, trad. fr. M. Jimenez, Paris, Klincksieck, “Esthétique”, 1994, notamment, p.100-107.
Régine Robin, art. cit., p.46. Ce thème de l’allégorie, qui place l’existence sous le signe de la fragmentation [Zerbrochenheit], est au cœur de l’interprétation que Benjamin donne du drame baroque allemand (L’origine du drame baroque allemand, Paris, Flammarion, 1985).
Lectures de Baudelaire (2)
Benjamin propose donc dans son livre une tentative originale pour inscrire l’expérience poétique de Baudelaire dans la perspective d’une analyse à la fois esthétique, sociologique et philosophique (au sens large) de la modernité, dont le poète dresse le tableau sans complaisance, en déployant son effort créateur à partir des transformations objectives de son environnement historique et social. De cette manière, Benjamin traite l’œuvre de Baudelaire comme une œuvre kaléïdoscopique, dans laquelle la modernité révèle ses propres contradictions, ses failles, ses limites, et au fond sa propre mythologie. On prend d’ailleurs d’autant mieux la mesure de l’ampleur du projet de Benjamin lorsque l’on confronte les perspectives qu’il développe dans son ouvrage sur Baudelaire et celles qu’esquissent, sur des plans très différents, et en un sens opposés, Sartre et Foucault. Sans doute s’agit-il, pour ces deux derniers, comme pour le premier, de rapporter l’examen du cas Baudelaire à des préoccupations personnelles qui éclairent à chaque fois d’un jour particulier les analyses qui en sont proposées : de même que les fragments du livre de Benjamin témoignent d’une réflexion générale sur le devenir historique de la culture, de même le travail de Sartre sur Baudelaire constitue-t-il en quelque sorte une annexe de L’Être et le néant dont il met à l’épreuve certaines intuitions et certaines méthodes, et les notes de Foucault, ajoutées à sa conférence américaine sur Qu’est-ce que les Lumières ?, s’inscrivent-elles dans le droit fil d’une interrogation sur notre rapport à la modernité (interrogation poursuivie depuis l’Histoire de la folie). Ainsi, malgré l’hétérogénéité de ces perspectives, force est de constater que la figure de Baudelaire s’impose comme une référence incontournable, comme un point de passage obligé lorsqu’il s’agit de traiter la question de l’avenir de la culture, du sens de l’existence ou de la fonction du présent : tout se passe comme si donc la modernité de Baudelaire tenait aussi à ce que, par son œuvre protéiforme, il offre des perspectives cavalières sur des problèmes clairement identifiés comme modernes : le destin de l’homme dans un monde sans Dieu, le rôle et la place de l’art dans une culture de masse, la fonction de l’historicité dans la réflexion philosophique. On peut noter à ce sujet qu’après le travail inachevé de Benjamin qui tend à englober tous les aspects de l’œuvre baudelairienne, qui embrasse en tout cas toutes ses modulations et ses expressions, Sartre et Foucault restreignent délibérément leur champ d’investigation : le premier livre une introduction à un recueil d’Écrits intimes (composés de confidences de Baudelaire sur lui-même et de la correspondance avec ses proches) alors que le second, qui avait sans doute pris connaissance des textes de Benjamin et de Sartre, se concentre plutôt sur l’essai consacré à Constantin Guys, “Le peintre de la vie moderne”. Ces choix bibliographiques rendent d’emblée la position de Sartre et celle de Foucault incompatibles entre elles et invite alors à mettre en relief cette incompatibilité en la rapportant aux perspectives et aux problèmes généraux abordés par Benjamin dans son travail. En effet, ce dernier décrivait les conditions de constitution d’une esthétique de la modernité fondée avant tout sur la conscience d’une crise affectant globalement les rapports de l’homme à son environnement socio-historique. Or, il semble que si Sartre, dans son essai, rapporte cette crise à la condition ontologique de l’homme lui-même et aux apories liées à l’attitude existentielle du poète, Foucault cherche pour sa part à penser l’unité d’une esthétique de la modernité et d’une esthétique de l’existence sur le fond de ce qu’il nomme une “héroïsation du présent” . De cette manière, s’esquissent ici en quelque sorte les deux versions possibles d’une critique de la modernité : sa version négative, chez Sartre, puisque la modernité de Baudelaire est justement ce qui le perd en l’enfermant dans des contradictions insolubles – mais aussi en un sens exemplaires du tragique propre à la condition humaine dans son ensemble ; et sa version positive, avec Foucault, puisque c’est la modernité elle-même qui, forte des tensions qui l’animent et dont le poète ou l’artiste font le diagnostic, apparaît comme une puissance critique susceptible d’éclairer les marges de transformation de notre présent et même de notre être historique.
La perspective adoptée par Sartre dans son essai sur Baudelaire est celle d’une “psychanalyse existentielle” appliquée à l’attitude poétique. Le postulat général sur lequel repose ce type d’analyse, présenté dans L’Être et le néant , est que l’homme se définit intégralement par les projets qu’il porte. Ces projets définissent l’existence individuelle comme une totalité finalisée, orientée vers des fins qu’il s’agit alors d’identifier pour restituer la qualité singulière d’une réalité-humaine comprise comme une totalité indivisible. Au lieu d’adopter, à l’égard de l’existence personnelle, une perspective analytique (celle de la psychologie empirique), qui cherche à en recomposer les différents éléments (intellectuels, affectifs) après les avoir décomposés, la psychanalyse existentielle se définit donc comme une démarche synthétique, qui cherche à comprendre cette existence plutôt qu’à l’expliquer, pour retrouver l’orientation générale qui donne son unité et sa signification au “choix originel” de Baudelaire, soit à son projet fondamental d’être poète. Notons que ce choix ne relève pas d'un psychisme inconscient (de type freudien), mais qu’il correspond plutôt dans l'optique sartrienne à un projet fondamental pleinement vécu par la personnalité consciente, qui s'y confond essentiellement dans la totalité de ses attitudes . Or, ce projet fondamental, qui est celui de la réalité-humaine que Baudelaire singularise dans son existence de poète, c’est celui, impossible, d’être Dieu (ou encore en-soi-pour-soi, causa sui). La réalité-humaine se caractérise en effet comme “dépassement perpétuel vers une coïncidence avec soi qui n'est jamais donnée” . Pour bien comprendre cette idée centrale, il faut rappeler que dans L'Être et le néant sont distinguées deux modalités d'être, irréductibles l'une à l'autre, mais dont les rapports forment le noyau paradoxal de la réalité-humaine : il s'agit de l'être-pour-soi et de l'être-en-soi. Par ces catégories, il s'agit de désigner l'être de la conscience et l'être de la chose, la conscience étant précisément ce qui n'est pas la chose, elle est transcendante à tout objet possible par l'intentionnalité qui la constitue comme conscience de quelque chose. Ainsi, le mode d'être de la conscience se caractérise d'emblée comme non-coïncidence avec soi, dans la mesure où cette conscience se dépasse elle-même vers ce dont elle est conscience, s'enlève sur fond de monde, c'est-à-dire sur fond de cet en-soi massif et inerte qui signifie l'identité opaque des choses. En effet, pour s'arracher au monde, la réalité-humaine doit être d'abord arrachement à elle-même comme à cet en-soi qu'elle n'est pas. Cet arrachement prend la forme d'un pouvoir de négation interne – ou de néantisation – qui appartient en propre à l'être-pour-soi : ce dernier se détermine lui-même comme “défaut d'être”, c'est-à-dire qu'il se “détermine perpétuellement lui-même à n'être pas l'en-soi. Cela signifie qu'il ne peut se fonder lui-même qu'à partir de l'en-soi et contre l'en-soi” . On voit ainsi l'ambiguïté de la détermination sartrienne du pour-soi, qui ne peut surgir que relativement à la totalité de l'en-soi qui l'entoure. En ce sens, il est lié originellement à cet en-soi qu'il n'est pas et cette laison définit sa facticité, ou encore sa contingence, inscrite au cœur même de sa transcendance : “Le pour-soi est soutenu par une perpétuelle contingence, qu'il reprend à son compte et s'assimile sans jamais la supprimer” . Il revient donc à la conscience d’assurer l’articulation de la transcendance et de la facticité dans la forme d'un “manque” constitutif. C’est ce manque qui inscrit dans la réalité-humaine le sens de son propre dépassement : car si l'homme souffre de son inconsistance, de son “défaut d'être” (qui est l’effet de sa transcendance), il ne peut vouloir non plus s'abolir totalement dans l'être (dans la facticité de l'en-soi). En sorte que son projet perpétuel et impossible à la fois consiste à vouloir être son propre fondement, soit à réaliser la synthèse du pour-soi (mouvement, néant) et de l'en-soi (être, repos) : en effet, de cette manière, “il serait son propre fondement non en tant que néant mais en tant qu'être et garderait en lui la transcendance nécessaire de la conscience en même temps que la coïncidence avec soi de l'être en-soi. Il conserverait en lui ce retour sur soi qui conditionne toute nécessité et tout fondement. Mais ce retour sur soi se ferait sans distance, il ne serait point présence à soi mais identité à soi” . La réalité-humaine paraît donc hantée par le désir d’être soi : il y a une tendance naturelle de chaque existence à se projeter dans une totalisation d'elle-même sans pouvoir la fonder. Et l’existentialisme procède à la description phénoménologique d'une conscience “malheureuse”, dont le malheur tient précisément à ce qu'elle ne peut être conscience que par son manque au regard de la totalité qu'elle n'est pas.
Un tel projet recèle donc une contradiction interne qui, en conditionnant le sens même de l'entreprise poétique de Baudelaire, lui confère paradoxalement, sa véritable valeur. C’est ce que Michel Leiris indique dans la préface qu’il rédige pour l’“Introduction” de Sartre une fois que celle-ci est devenue un livre autonome :
[Il s’agit d’une] aventure qui apparaît comme la quête d'une impossible quadrature du cercle (fusion être-existence à quoi s'acharne tout poète selon la voie qui lui est propre). Aventure sans épisodes sanglants mais qu'on peut regarder comme appartenant au tragique, en tant qu'elle a expressément pour ressort la dualité insurmontable de deux pôles, source pour nous – sans rémission possible – de trouble et de déchirement .
Le drame baudelairien paraît en effet se nouer à partir d'une dynamique qui polarise son expérience – vécue et poétique – sans jamais lui donner la forme d'une totalité définitive, ici désignée par la “fusion être-existence”. Or, précisément, l'intérêt du “choix originel” de Baudelaire est, selon Sartre, d'avoir poussé à bout cette tension caractéristique de la réalité-humaine, en vue de fonder absolument sa propre existence (d’être causa sui, comme le Dieu-Substance de Spinoza). Tout son effort, héroïque et dérisoire à la fois, peut être décrit en effet comme un “effort de récupération” qui tend à réaliser la synthèse de l'en-soi (l'être) et du pour-soi (de l'existence), dans la forme nécessairement contradictoire d'une “liberté-chose”. Dans ces conditions, le drame de Baudelaire tient précisément à ce qu'il a inscrit sa démarche poétique et sa vie à l'intérieur même de cette contradiction insoluble : son choix originel est donc le mauvais choix, le choix d'une “conscience perpétuellement déchirée, [d']une mauvaise conscience” . En ce sens, il fournit l'illustration parfaite de ce “malheur” inhérent à la condition humaine, déchirée entre sa facticité et sa transcendance, entre un monde qui est sa propre justification parce qu’il est absolument nécessaire et une liberté injustifiable par principe. Mais Sartre ne s'en tient pas à ce constat : ce qui l'intéresse et – jusqu'à un certain point le fascine – chez Baudelaire, c'est précisément qu'il a consacré sa vie à tenter de lever la contradiction originelle entre son choix d'être et son choix d'exister. Autrement dit, à travers l'ensemble des attitudes (par rapport à la nature, au travestissement, au passé) qui expriment en le compliquant le choix originel du poète – qui disent de manière singulière et différenciée ce que signifie “être un poète” – point un effort constant pour se tenir à la fois sur le plan de l'être et sur le plan de l'existence : pour tenter de saisir dans le miroir qu’il se tend le reflet de sa propre spontanéité – pour se posséder lui-même. Ainsi, si Baudelaire cherche à “se dresser à l’écart de la grande fête sociale, à la manière d’une statue, définitif, opaque, inassimilable”, en même temps, il refuse que cette statue ne soit qu’“un pur donné de hasard”, il cherche à établir que cette chose – qu'il est en un certain sens, “s’est créée elle-même, et qu’elle se soutient d'elle-même à l'être” .
Par conséquent, si la tentative existentielle du poète consiste à atteindre à une véritable possession de soi en surmontant la dualité qui polarise l’expérience humaine, il apparaît qu’un tel projet de coïncidence avec soi reconduit à ce que Sartre désigne comme l’“ambiguïté” même de la notion de possession :
On ne se possède que si l'on se crée et si l'on se crée, on s'échappe ; on ne possède jamais qu'une chose ; mais si l'on est chose dans le monde on perd cette liberté créatrice qui est le fondement de l'appropriation .
De cette manière, il semble que le choix baudelairien, tel que l'analyse Sartre, puisse être caractérisée comme un choix de “mauvaise foi”, c’est-à-dire comme une tentative pour jouer des deux propriétés opposées de la réalité-humaine, – sa transcendance et sa facticité. La mauvaise foi de Baudelaire consiste ainsi à se présenter lui-même comme transcendance mais sur le mode de la facticité, ou inversement comme facticité mais sur le mode de la transcendance. Du coup, son effort se trouve sans cesse reconduit à la même ambiguïté constitutive :
Parce qu'il a voulu à la fois être et exister, parce qu'il fuit sans relâche l'existence dans l'être et l'être dans l'existence, il n'est qu'une plaie vive aux lèvres largement écartées et tous ses actes, chacune de ses pensées comportent deux significations, deux intentions contradictoires qui se commandent et se détruisent l'une l'autre .
A travers ces glissements et cette instabilité, on retrouve la contradiction motrice de la démarche baudelairienne, ce qui fait de son aventure une “impossible quadrature du cercle” : il se met à distance pour se posséder, il se dédouble pour réaliser l'identité avec soi, ou encore il cherche à atteindre la spontanéité par la réflexion.
Or, cette démarche se poursuit à la fois sur le plan des conduites existentielles et sur le plan de la pratique poétique, analysée par Sartre dans les dernières pages de son Introduction Le philosophe ne se contente pas en effet d’analyser l’ambiguïté constitutive de la personnalité individuelle de Baudelaire ; il vise bien à montrer que cette ambiguïté travaille sa poésie, qu’elle est même son ressort le plus propre : tout l’effort de Baudelaire peut ainsi se caractériser par le mouvement général de “spiritualisation” qui s’applique aussi bien à son existence qu’à son verbe. Le “spirituel” (dont le parfum est une émanation caractéristique), désigne l’évanescence de la réalité, son apparition-disparition, sa présence-absence, bref son régime d’être ambigu, ni complètement de l’ordre de l’être ni complètement assimilé à celui l’existence, mais se tenant exactement à la limite de ces deux ordres :
Le spirituel est le fait poétique baudelairien. Le spirituel est un être et qui se manifeste comme tel : de l’être, il a l’objectivité, la cohésion, la permanence et l’identité. Mais cet être enferme en lui comme une sorte de retenue, il n’est pas tout à fait, une discrétion profonde l’empêche non de se manifester, mais de s’affirmer à la manière d’une table ou d’un caillou il se caractérise par une manière d’absence, il n’est jamais tout à fait là ni tout à fait visible, il reste en suspens entre le néant et l’être par une discrétion poussée à l’extrême. […] Il va de soi que cette légèreté métaphysique du monde baudelairien figure l’existence elle-même. Quiconque a lu les admirables vers du Guignon :
Mainte fleur épanche à regret
Son parfum doux comme un secret
dans les solitudes profondes
a pressenti ce goût de Baudelaire pour ces étranges objets qui sont comme des affleurements à l’être et dont la spiritualité est faite d’absence .
Le “spirituel”, qui est la dimension propre à la poésie de Baudelaire est donc aussi son mode d’être existentiel. L’existence du poète (voué à la quadrature du cercle de l’impossible fusion être-existence) et la poésie comme mode d’existence (c’est-à-dire comme spiritualisation de cette existence dans un langage qui exprime au fond ses propres apories) constituent les deux faces d’un même projet fondamental, irrésistiblement voué à l’échec.
Il est clair que le Baudelaire des Écrits intimes que nous présente Sartre se situe au plus loin du Baudelaire du Spleen de Paris et des “Tableaux parisiens” qui avait tant fasciné Benjamin. Pour Sartre, l’isolement du poète n’est pas une posture historique, une réaction à la teneur traumatisante du contact avec les foules ; il tient seulement à ce qu’il est un “homme penché” , un homme recroquevillé même sur son propre sort tragique, victime éternelle d’une “fêlure” originelle, sur fond de drame familial (le remariage de sa mère avec le Général Aupick). Baudelaire en ce sens incarne de manière exemplaire l’échec de la conscience à pouvoir coïncider avec elle-même dans la forme pleine et stable d’un moi absolu ; et il incarne aussi l’échec de la poésie, bloquée dans cette tension douloureuse entre l’être et le néant et incapable de produire autre chose que du “spirituel”, c’est-à-dire exactement un mixte d’être et de néant, de réel et d’irréel, un pur effet de l’imagination créatrice – aux antipodes de la communication claire qu’est censée proposer le prosateur (selon le clivage établi dans Qu’est-ce que la littérature ?). Il est possible alors de se demander si, pour Sartre, ce n’est pas la modernité poétique elle-même, telle que la présentait Benjamin, qui est mise en échec et stigmatisée à travers la figure de Baudelaire. Car la dialectique de l’être et de l’existence, on pourrait dire du figé et du mouvant, ou même de l’éternel et du transitoire, qui est au cœur de l’expérience baudelairienne, est présentée ici comme une dialectique bloquée, sans autre issue que la fuite en avant, et donc de mauvaise foi, vers une “spiritualité” qui, à défaut de la résoudre, transforme la contradiction en ambiguïté pour en amortir les effets traumatisants. D’une certaine manière, Sartre écrit et pense contre Baudelaire, contre cette misère de la poésie moderne qu’il incarne trop bien et à laquelle l’écrivain engagé se fait fort d’échapper. A l’opposé, Benjamin pense avec Baudelaire et s’il analyse déjà, au cœur de l’entreprise poétique, un effort de “récupération”, cet effort échappe selon lui aux simples mirages de la réflexivité et engage directement, concrètement, le poète dans la modernité comme dans un combat (une “fantasque escrime”) avec (ou contre, mais tout contre) cette évanescence traumatisante d’une réalité en voie de transformation radicale. Dans ces conditions, la “perte d’auréole” du poète prend deux sens très différents. Pour Sartre, Baudelaire est doublement irrécupérable : il l’est d’abord comme existant singulier, miroir de la condition humaine et de ses impuissances (car l’homme est une “passion inutile” , et Baudelaire se perd en vain dans le labyrinthe de l’attitude poétique) ; il l’est de surcroît comme poète (son crime impardonnable n’est-il pas d’avoir osé faire de la poésie avec de la prose, ou d’avoir recherché “le poétique dans la prose” ?). Ainsi, à travers lui, comme à travers Mallarmé ou Flaubert, c’est la modernité qui semble vouée à l’échec, du moment qu’elle se caractérise par son “goût du néant”. Pour Benjamin, au contraire, l’œuvre poétique moderne, qui est avant tout l’œuvre d’un chiffonnier (cet archéologue des temps modernes), se fonde justement sur l’irrécupérable de la culture, les traces laissés par les chocs, pour produire du nouveau.
Il reste alors à situer les notes de Foucault sur Baudelaire dans ce vaste “tableau” . Manifestement, en privilégiant l’essai sur “Le peintre de la vie moderne”, Foucault tend à se situer dans l’orbe des analyses de Benjamin puisqu’il place au cœur de son propos le rapport entre l’expérience historique et l’expérience esthétique qui ici, à travers le miroir kantien de la critique, s’éclairent l’une par l’autre et se réfléchissent l’une dans l’autre : être moderne, c’est adopter une attitude à l’égard de la continuité de l’histoire qui conduit à prendre “conscience de la discontinuité du temps” et, on pourrait dire, des chocs qu’implique cette discontinuité, pour discerner, au cœur de cette expérience de la discontinuité, ce qui constitue la forme même d’un rapport critique au présent, conçu comme l’écart entre la contingence de l’instantané et la nécessité propre à l’époque. Tout l’art du poète ou du “peintre de la vie moderne” consiste alors à prendre et à donner la mesure d’un tel écart, à faire voir ou entendre la modernité de la mode (et du moderne) pour que se manifeste dans leurs œuvres singulières non pas seulement les instantanés d’une époque déterminée, mais bien la “réactivation permanente” d’une attitude de modernité valant avant tout comme une “critique permanente de notre être historique” , donc aussi de ce culte du nouveau (toujours changeant et toujours identique) qui se donne comme une forme illusoire, fantasmagorique, de la discontinuité. Baudelaire peut ainsi être assimilé à un penseur de la modernité comme crise, et en un sens les rapprochements que Benjamin esquisse entre le poète maudit et Nietzsche trouvent un relais chez Foucault dans la reformulation kantienne du thème critique, en rapport avec l’exigence politique et éthique d’un “travail sur nos limites” fondé sur un rapport intempestif, inactuel, au présent en tant que tel.
De ce point de vue, la signification “critique” que Foucault accorde à la posture esthétique de Baudelaire, peut également s’inscrire dans le cadre d’une confrontation indirecte avec l’analyse de Sartre, en opposant justement à l’attitude de “contre-modernité” que ce dernier illustre dans son étude de cas, l’“attitude de modernité” dont Baudelaire (après Kant et avec Nietzsche ) est ici présenté comme le héros. De fait, cette confrontation se développe sur trois plans – qui correspondent aux trois points principaux abordés par Foucault à propos de Baudelaire dans sa conférence et qui tendent à reprendre certains éléments fondamentaux de la conceptualité sartrienne (choix, liberté, existence) tout en en décalant significativement les enjeux.
Foucault commence en effet par analyser l’attitude de modernité de Baudelaire en tant qu’elle renvoie à l’ordre d’un “choix volontaire” à l’égard du présent. Ce choix déterminé, qui forme la condition même de la lucidité de l’artiste, s’oppose ainsi à toutes les formes d’acceptation passive du changement qui conduisent à une idôlatrie de la mode, à une fascination sans distance pour le spectacle du contingent. L’“héroïsme de la vie moderne” consiste au contraire à dépasser cette passivité (le poète, témoin du “déclin de l’aura”, ne peut plus tenir le rôle du pur contemplateur) sans pour autant nier le caractère éphémère du réel quotidien, qu’il soumet à un effort d’esthétisation, – mais d’esthétisation ironique, puisqu’à la beauté abstraite et indéfinissable des classiques se substitue désormais une beauté bizarre, irrégulière, à l’image et à la mesure de l’irrégularité du réel lui-même. On voit comment ce thème d’une héroïsation ironique du présent, qui repère dans le présent lui-même la possibilité d’un écart entre l’actuel et l’inactuel, entre l’historique et le poétique, se sépare de la description pathétique du poète comme l’“homme penché” qui, dans le choix irréfléchi qu’il a fait de lui-même, semble s’être condamné à n’être qu’une plaie ouverte, qu’un être fêlé, subissant son destin d’existant au fur et à mesure qu’il croit l’inventer . Le choix d’être poète qui forme la matrice de l’analyse sartrienne du cas Baudelaire est donc un choix par défaut, un choix que lui imposent les circonstances et avec lequel il tente de se débrouiller – le fait d’être poète étant d’ailleurs une manière d’éviter d’assumer ce choix en fuyant ses responsabilités dans le réel et en soumettant ce réel au travail transfigurateur de l’imagination. Pour Foucault à l’inverse, le choix d’être poète ou peintre de la vie moderne témoigne moins d’une disposition de la conscience à l’égard d’elle-même que de l’engagement volontaire, concret, au cœur d’une réalité présente, vécue simultanément sur le mode contraignant de l’appartenance et sur celui, créateur, de la tâche transformatrice. Baudelaire devient ainsi le paradigme de l’écrivain engagé.
Ceci nous conduit alors au second thème de l’intervention de Foucault qui concerne les modalités de cet engagement poétique ou artistique dans et pour la modernité :
Pour l’attitude de modernité, la haute valeur du présent est indissociable de l’acharnement à l’imaginer, à l’imaginer autrement qu’il n’est et à le transformer non pas en le détruisant mais en le captant dans ce qu’il est .
L’imagination, mise au service d’une beauté concrète, constitue ainsi le vecteur privilégié d’une transfiguration du réel qui équivaut moins à sa destruction qu’à la manifestation de son essence même, de ce qu’il y a d’essentiel ou d’absolu dans sa relativité. Imaginer le présent, c’est alors en un sens être capable de se déprendre de lui sans cesser d’y appartenir, être capable donc de le « prendre » autrement qu’il n’est à première vue (sordide) pour capter, de biais, sa plus “haute valeur” (sa valeur d’usage poétique). Cette imagination créatrice qui est solidaire du mouvement de poétisation du fugitif caractérisant la modernité de Baudelaire, résulte selon Foucault d’un “jeu difficile entre la vérité du réel et l’exercice de la liberté” qui prend la forme d’une transformation immanente de la réalité en beauté. On est donc à nouveau au plus loin de la problématique sartrienne qui tend à présenter le travail de l’imagination non pas sous l’angle d’une pratique transformatrice mais bien plutôt sous celui d’une activité, propre à la transcendance de la conscience, de néantisation du donné. Le propre du poète et sa limite, selon Sartre, tiennent en effet justement à ce qu’il fait le choix de l’irréel plutôt que du réel et qu’il incarne jusque dans la mauvaise foi la fonction néantisante de la conscience imageante. Or, Foucault prend soin de soustraire le travail de l’imagination et l’exercice de la liberté à toute forme de négativité qui risque de renvoyer complètement la poétique de la modernité du côté d’un “goût du néant” pris alors comme le symptôme d’une conscience malade, morbide, tendanciellement coupée du réel. Au thème de la néantisation sartrienne, s’oppose par conséquent celui d’un “jeu” du réel et de la liberté. L’artiste est celui qui fait jouer le réel contre lui-même, qui en fait varier les aspects, pour en révéler les propres potentialités transformatrices.
Cette puissance immanente de transformation et de contestation, propre à l’activité transfiguratrice de l’imagination, concerne non seulement le rapport au présent, mais aussi le rapport à soi. Il y a en effet un exercice de la liberté qui s’applique à l’artiste lui-même en tant qu’il peut faire “de son corps, de son comportement, de ses sentiments et passions, de son existence, une œuvre d’art” . La figure du dandy, redoublant celle du poète, vient donc compléter le tableau esquissé par Foucault, en donnant à l’attitude esthétique de modernité son sens proprement éthique qui prend appui ici sur un ensemble de pratiques ascétiques visant à une transformation de soi par soi. Celle-ci équivaut à une invention (on pourrait dire à une imagination) positive de soi dans la perspective d’un écart par rapport à la norme des comportements individuels et sociaux. De manière significative, Foucault prend soin de distinguer cette figure du dandy de celle que Sartre avait stigmatisée dans son “Introduction” aux Écrits intimes de Baudelaire :
L’homme moderne, pour Baudelaire, n’est pas celui qui part à la découverte de lui-même, de ses secrets et de sa vérité cachée ; il est celui qui cherche à s’inventer lui-même. Cette modernité ne libère pas l’homme en son être propre ; elle l’astreint à la tâche de s’élaborer lui-même..
L’esthétique de l’existence n’est donc pas le reflet amplifié de l’impuissance ontologique de l’homme : elle n’est pas une conduite d’échec du poète incapable d’exister sur le mode de l’être et fuyant cet échec dans la mauvaise foi et le délire de l’imagination poétique. On voit ici à nouveau le renversement : ce qui était tenu par Sartre pour le principe pathologique de l’attitude du poète, excessivement préoccupé de lui-même et de sa vérité ultime (à conquérir sous la forme idéalisée d’une coïncidence avec soi), devient pour Foucault l’accomplissement de la modernité esthétique, sa possible transformation en une éthique de la modernité. Être moderne, c’est en effet, si l’on suit cette dernière piste, être capable de faire jouer les formes actuelles de son existence (personnelle mais aussi sociale) en vue de transformer son rapport au présent ; de penser autrement en transformant son rapport à soi. C’est sur ce point sans doute que Foucault, à l’écart de la démarche sartrienne, déborde finalement les analyses de Benjamin dont il réinscrit les réflexions, historiques et esthétiques, au cœur de sa propre préoccupation d’une modernité envisagée avant tout d’après son potentiel critique et sa dimension éthique.
Jean-Paul Sartre, L’Être et le néant, Paris, Gallimard, “Bibliothèque des Idées”, 1943 ; rééd. “Tel”, 1976, Quatrième partie, Chapitre II, p.616-635.
De ce point de vue, il serait intéressant de comparer l’étude de Sartre et celle du Docteur René Laforgue, L’Échec de Baudelaire. Étude psychanalytique sur la névrose de Charles Baudelaire (Paris, Denoël et Steele, 1931) dont le premier avait sans doute pris connaissance au moment d’écrire son “Introduction” aux Écrits intimes. Benjamin mentionne lui-même de manière critique le travail de Laforgue au début de “Zentralpark” (Charles Baudelaire, p.211).
Ibid., p.26. Voir aussi, p.64-65. Jean-François Louette a proposé une interprétation du Baudelaire fondée sur l’usage d’une certaine méthode dialectique (« une quasi dialectique et sans synthèse », comme il est dit dans les Cahiers pour une morale, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de philosophie », 1983) qui se retrouve également dans le livre sur Genet et plus généralement dans la plupart des analyses biographiques de Sartre (voir « La dialectique dans la biographie », in Les Temps Modernes, n°531-533, oct.-déc. 1990, « Témoins de Sartre », vol. 2, p.720-759).
Ibid., p.75. Sartre évoque ici (et plus loin encore, p.178) “L’Héautontimoroumenos” :
“Je suis la plaie et le couteau !
Je suis le soufflet et la joue !
Je suis les membres et la roue,
Et la victime et le bourreau !”
(Baudelaire, Les Fleurs du mal, “Spleen et Idéal”, LXXXVI)
Voir notamment les pages consacrées au “fait poétique baudelairien” (Baudelaire, p.160 et suivantes).
Voir Jean-Paul Sartre, L’Idiot de la famille, Paris Gallimard, 1971, t.I, p.8. Voir également le travail de Pierre-Henry Frangne, La négation à l’œuvre. La philosophie symboliste de l’art (1860-1905) (Rennes, PUR, “Æesthetica”, 2005) qui analyse le rapprochement opéré par Sartre entre Mallarmé, Flaubert et Baudelaire – comme figures paradigmatiques du symbolisme littéraire (p.339-345).
Il est possible de noter que Foucault consacre très peu de pages dans toute son œuvre à Baudelaire. le “poète maudait” ne paraît pas faire partie de la lignée des écrivains transgressifs qu’évoquent les premiers travaux de Foucault. Sur l’introduction de la référence à Baudelaire dans la conférence de 1984, voir l’article détaillé de Fabienne Brugère : “Foucault et Baudelaire. L’enjeu de la modernité”, in P.-F. Moreau (dir.), Lectures de Michel Foucault. Sur les Dits et écrits, volume 3, Lyon, ENS Éditions, “Theoria”, 2003, p.79-91.
Benjamin assignait à l’historien matérialiste la tâche de “faire éclater la continuité de l’histoire” (Thèses sur la philosophie de l’histoire, in Walter Benjamin, Œuvres, II. Poésie et révolution, trad. fr. M. de Gandillac, Paris, Denoël, “Les Lettres Nouvelles”, 1971, Thèse 16).
Sur le rapprochement entre Baudelaire et Nietzsche, voir Jean Lacoste, L’Aura et la rupture, p.95-96.
Tel est le sens de la dernière phrase du Baudelaire de Sartre : “Le choix libre que l’homme fait de soi-même s’identifie absolument avec ce qu’on appelle sa destinée” (p.179).
Sartre consacre lui-même une longue analyse au “dandysme” de Baudelaire (Baudelaire, p.123-149), rabattu sur une conduite de mauvaise foi : “Par des obligations constamment renouvelées, [Baudelaire] se masque son gouffre : il est d’abord dandy par peur de soi […]. Notons que le dandysme, par sa gratuité, par la libre position de valeurs et d’obligations, s’apparente au choix d’une Morale. Il semble que, sur ce plan, Baudelaire ait donné satisfaction à cette transcendance qu’il a découverte en lui dès l’origine. Mais c’est une satisfaction truquée. Le dandysme n’est que l’image affaiblie du choix absolu de valeurs inconditionnelles” (p.124).

Philippe Sabot
Professeur de philosophie
(philosophie contemporaine et sciences humaines)
à l'université Lille 3.
Département de Philosophie - UFR Humanités
UMR 8163 "Savoirs, Textes, Langage" (CNRS-Lille3/Lille1)
Principaux domaines de recherche :
*Philosophie française contemporaine
*Littérature, philosophie et sciences humaines
*Usages de l'hégélianisme dans la littérature et en philosophie (en France aux XIXe et XXe siècles)
Une brève présentation de mon parcours académique
Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure de la rue d'Ulm (1990-1994).
Agrégé de philosophie (1993).
Docteur en philosophie (1999).
Ma thèse s'intitulait Pratiques d'écriture, pratiques de pensée. Le statut philosophique de l'expérience littéraire, du surréalisme à nos jours. Ce travail a été dirigé par Pierre Macherey et soutenu à l'université de Lille 3 devant un jury composé de Mme Catherine Kintzler (Lille 3) et de MM. Alain Badiou (ENS, Paris), Jacques Deguy (Lille 3), Claude Imbert (ENS, Paris) et Pierre Macherey (directeur de thèse, Lille 3).
Ce travail de doctorat a donné lieu à la publication de trois ouvrages :
- Pratiques d'écriture, pratiques de pensée. Figures du sujet chez Breton/Eluard, Bataille et Leiris (PUSeptentrion, "Philosophie contemporaine", 2001).
- Philosophie et littérature. Approches et enjeux d'une question (Paris, PUF, "Philosophies", 2002).
- Littérature et guerres. Sartre, Malraux, Simon (PUF, "Lignes d'art", 2010).
Habilité à diriger des recherches en philosophie (2006).
J'ai soutenu mon HDR à Paris 1 devant un jury composé de MM. Guillaume le Blanc (Bordeaux 3), Pierre Macherey (Lille 3), Jean Salem (Paris 1), Michel Senellart (ENS-LSH), FRancis Wolff (Paris 1 - ENS Ulm, Garant de l'Habilitation).
Mon travail d'habilitation comportait deux recueils d'articles et d'études consacrés pour l'un aux rapports entre philosophie et littérature, pour l'autre à la pensée de Michel Foucault ainsi qu'à celle de Ludwig Feuerbach. Je proposais également un commentaire inédit des Mots et les choses de Michel Foucault.
La seconde partie de ce manuscrit inédit a été publiée en 2006 sous le titre: Lire Les Mots et les choses de Michel Foucault (PUF, "Quadrige"). La publication de la première partie du commentaire est en préparation.
Lien vers ma page individuelle sur le site de l'UMR "Savoirs, textes, langage":
http://stl.recherche.univ-lille3.fr/sitespersonnels/sabot/accueilsabot.html
Contact :
Twitter : @PhilippeSabot
Attachement et relationnalité : Butler face à Hegel[1]
Parmi les travaux philosophiques récents qui contribuent à réactualiser le contenu de la pensée hégélienne, et à en explorer ainsi la fécondité théorique au-delà de son ancrage doctrinal[2], il est sans doute possible de réserver une place particulière à Sois mon corps[3], un ouvrage co-écrit par Judith Butler et Catherine Malabou et publié en 2010. Ce petit ouvrage retient en effet d’emblée l’attention par sa forme originale, puisqu’il se compose de deux essais brefs et denses rédigés par les deux auteures, eux-mêmes complétés par un dialogue qui en éclaire et en approfondit les enjeux sans chercher nécessairement à réconcilier les points de vue exprimés. Mais l’originalité de cet opuscule tient aussi à son contenu dans la mesure où cette rencontre à deux voix et à quatre mains se noue à l’occasion d’une « lecture contemporaine de la domination et de la servitude chez Hegel », ainsi que l’indique le sous-titre de l’ouvrage. Cet intérêt porté au texte de Hegel portant sur la dialectique du maître et de l’esclave dans le chapitre IV de la Phénoménologie de l’esprit n’est pas anodin. Il s’inscrit manifestement dans la tradition de lecture et d’interprétation ouverte par Kojève qui en a proposé une interprétation libre et retentissante à l’occasion des cours qu’il a consacrés à la lecture de l’ouvrage de Hegel entre 1933 et 1939 à l’Ecole des Hautes Etudes[4]. C’est grâce à lui notamment, puis quelques années plus tard grâce à la traduction et au long commentaire fournis par Hyppolite[5], que les passages portant sur « domination et servitude » ont connu cette fortune considérable qui a contribué à susciter, d’abord en France puis aux Etats-Unis[6], un intérêt pour cet ouvrage jusque là à peu près complètement négligé en France par les lecteurs de Hegel.
Sois mon corps n’est pas le premier ouvrage où J. Butler et C. Malabou se confrontent à la pensée hégélienne. On pourrait même dire que les travaux de ces auteures se sont pour une large part élaborés d’après Hegel, en proposant au fil de leurs lectures successives de Hegel des usages contemporains de sa réflexion qui en exploitent librement certaines thématiques (la forme, le désir, la reconnaissance, la vie, etc.) en vue d’élaborer avant tout de nouveaux problèmes (liés en particulier aux métamorphoses du corps, aux politiques de la sexualité et à la gestion différentielle de l’humain qu’elles mettent en œuvre). J. Butler s’est ainsi intéressée à plusieurs reprises à la figure de la domination/servitude, dont elle a notamment donné une interprétation audacieuse, en rapport avec la thématique foucaldienne de l’assujettissement, dans La Vie psychique du pouvoir[7]. « Sois mon corps » [You be my body for me], la formule qui donne son titre au texte-dialogue de Judith Butler et de Catherine Malabou, est d’ailleurs directement extraite du premier chapitre de cet ouvrage dans lequel Judith Butler vise à éclairer les figures de la « conscience malheureuse » à partir de ce qu’elle analyse comme le « paradoxe de l’assujettissement corporel »[8]. Ce paradoxe est lié à la dialectique du maître et de l’esclave et plus précisément au « tour de passe-passe » qu’elle implique quant aux positions de ces deux personnages à l’égard de la vie du corps – laquelle forme sans doute l’enjeu principal des essais rassemblés dans Sois mon corps. En effet, il ne suffit évidemment pas que le maître se dégage de toute vie corporelle pour être le maître. Du moins sa domination ne s’atteste-t-elle que dans la relation complexe qui se noue alors entre le maître et l’esclave – relation de dépendance mutuelle. Car si, immédiatement, l’esclave dépend du maître pour sa propre survie (puisqu’il est devenu esclave du fait de son « attachement obstiné » à la vie), le maître lui-même en vient à dépendre médiatement du travail – donc du corps laborieux – de l’esclave pour assurer les conditions de sa propre maîtrise. Mais, pour que le maître reste en position de domination, il faut que ce second aspect de la dépendance demeure masqué. D’où la double injonction que le maître adresse au valet et par laquelle leurs destins se trouvent étroitement liés : « Sois mon corps à ma place, mais ne me dis pas que ce corps que tu es est mon corps [you be my body for me but don’t let me know that the body you are is my body] »[9]. Dans La Vie psychique du pouvoir, Judith Butler analyse alors les conséquences décisives de ce contrat tacite sur l’esclave et elle montre notamment comment cette injonction qui lui est faite d’être le corps du maître sans le dire, le conduit à devenir une « conscience malheureuse » en rejouant en lui-même la relation de domination/servitude. En effet, l’autonomie à laquelle l’esclave croit accéder par son labeur reste une autonomie en trompe-l’œil dans la mesure où elle repose sur une dépendance originaire de l’esclave à son maître : ce dernier ne lui a délégué son corps que pour en tirer un bénéfice secondaire, lié à ce que l’esclave produit par son travail non pour lui-même mais pour un autre (le maître qui en jouit). L’esclave fait ainsi l’expérience douloureuse de la désappropriation continuelle des objets qu’il produit, en tant qu’ils sont consommés ou utilisés par le maître. Or, cette désappropriation objective vaut comme une précarisation subjective du serviteur puisque son être est tout entier objectivé dans ce qu’il produit. Dépossédé de ce qu’il a produit, le travailleur se trouve comme dépossédé de lui-même. Il fait l’expérience de sa propre finitude :
Le corps travailleur qui sait maintenant qu’il a formé l’objet sait aussi qu’il est lui-même transitoire. Le serviteur nie les choses (au sens où il les transforme par le travail), il est lui-même une activité négatrice mais il se découvre sujet à une négation pleine et définitive dans la mort. Cette confrontation avec la mort à la fin du chapitre rappelle la lutte pour la vie et la mort qui l’inaugurait[10].
Mais cette fois, la peur de la mort n’est plus « une menace exercée par un autre », elle se donne comme le « destin inévitable de tout être dont la conscience est déterminée et incarnée »[11]. C’est ici, et à nouveau dans un certain rapport au corps, que se joue selon Judith Butler la transition de la conscience servile à la conscience malheureuse. En effet, l’esclave prend conscience de ce que « son » corps, c’est-à-dire ce corps que le maître lui a délégué en même temps qu’il lui a enjoint de faire comme s’il était le sien propre, le renvoie en permanence à sa propre mortalité, qui est elle-même à l’origine de sa domination puisque le serviteur est depuis le début soumis au maître à cause de sa propre peur de la mort. Ainsi, dès lors que le corps est reconnu comme ce qui expose à la menace de la mort et par là nuit au « projet de sécurité et d’autosuffisance qui gouverne la trajectoire de la Phénoménologie »[12], il va se trouver refusé et désavoué. Et ce désaveu, loin d’installer l’esclave dans la position du maître (qui avait conquis cette position en refusant le corps et en le déléguant à un autre, devenu son esclave), renouvelle l’attitude de déni du corps en lui donnant la forme éthique d’une renonciation et d’une mortification. Dans ces conditions, la conscience intériorise la relation maître/esclave, d’abord posée dans l’extériorité d’une relation objective, puisqu’elle s’efforce désormais de devenir maître de son propre corps en le soumettant à des impératifs éthiques : la conscience malheureuse émerge donc à partir de cette transformation de la peur de la mort en peur de la loi, de cette métamorphose de l’assujettissement à un maître en auto-assujettissement à des normes éthiques[13].
Ces développements de La Vie psychique du pouvoir mettent en lumière, au cœur du texte hégélien, un double enjeu. A un premier niveau, ce qui est d’abord en question dans l’élaboration dialectique des relations entre le maître et le serviteur n’est autre que leur relation problématique au corps, à leur propre corps comme au corps de l’autre. Cette relation, dont la formule-titre « Sois mon corps » recèle toute l’ambiguïté, se fonde en effet sur l’exigence d’un détachement (puisque le corps est ce qui se délègue, qu’il a donc « lieu ailleurs, comme ou dans un autre corps »[14] - qui n’est lui-même que l’envers d’un attachement à soi, c’est-à-dire d’un « attachement aux conditions de la formation de soi »[15]. Le détachement absolu est-il alors possible ? Telle est la question que Catherine Malabou élabore patiemment dans son essai qui semble déboucher sur un paradoxe : un certain « attachement obstiné au détachement » serait le prix à payer de l’impossibilité d’un détachement absolu. Pourtant, ce parcours de « Domination et servitude » ne permet pas d’en épuiser la signification. Du moins Judith Butler propose-t-elle dans son propre essai d’en renouveler la lecture en mettant en perspective la figure même de la domination/servitude à partir de l’analyse hégélienne de l’apparition de la conscience comme forme, et comme forme vivante. Du coup, c’est la notion même d’attachement qui se trouve problématisée. En effet, l’attachement est-il attachement à la vie en général (ce qui suppose un certain détachement à l’égard de « sa » vie) ou attachement à sa vie (qui se paye d’un détachement à l’égard de la vie en général) ? Y a-t-il en d’autres termes un attachement absolu, une forme absolue d’attachement à soi dont le « corps » par exemple pourrait être le garant ? Nous allons voir que ces interrogations, nées du croisement des méditations hégéliennes de C. Malabou et de J. Butler, ouvrent en réalité le texte de Hegel à sa propre polyphonie, et à des enjeux proprement contemporains.
*
L’essai de C. Malabou problématise d’emblée le rapport à la vie du corps en le situant sous l’horizon de l’engrenage dialectique de la domination et de la servitude, lui-même repensé en termes de détachement et d’attachement :
Malgré les dires de Hegel, la dialectique peut-elle réellement à la fois admettre et produire la possibilité d’un détachement absolu de la vie et du corps ou bien l’attachement (servile) apparaît-il toujours chez Hegel en fin de compte comme la vérité de tout détachement ?[16]
Ce questionnement ne s’adresse toutefois à Hegel – et à la dialectique – que par l’intermédiaire de certains de ses interprètes-ventriloques (Kojève et Bataille) qui explorent déjà l’ambiguïté (et peut-être l’impossibilité) d’un détachement absolu. Ainsi, pour Kojève, la possibilité d’un tel détachement paraît être la condition nécessaire de l’humain – lequel s’atteste justement dans sa capacité à s’arracher à la vie animale attachée à la seule satisfaction des besoins naturels et, par cet arrachement même, à accéder à une vie symbolique : « La conscience se libère et se détache de la vie en lui donnant la parole, en transformant la vie en vie du langage, en détachant ainsi la vie d’elle-même »[17]. Mais ce détachement par et dans le symbolique qui paraît d’abord assurer la maîtrise du maître sur sa propre vie ainsi mise à distance d’elle-même et libérée de sa naturalité, demeure éminemment problématique dans la mesure où il est conditionné par l’attachement premier que l’esclave manifeste à l’égard de son corps dans le travail et dans le service du maître. L’interprétation kojévienne de la dialectique du maître et de l’esclave fait donc apparaître la présence de l’attachement au cœur du détachement, comme ce qui rend à la fois possible et impossible la perspective de la maîtrise absolue. Le maître trouve sa vérité dans l’esclave qui lui-même tient sa vérité du maître. C’est cette présupposition réciproque des figures de la domination et de la servitude qui signe l’échec, ou comme le dit Kojève « l’impasse existentielle », de la dialectique.
Comme le note C. Malabou, Bataille ne manque pas alors de souligner cette aporie en opposant à la posture d’une maîtrise conditionnelle l’exercice d’une « souveraineté » qui excède tout attachement à la vie dans la dépense en pure perte de l’érotisme et du don :
Un tel détachement s’accomplit selon une stratégie de la relève qui imite l’Aufhebung tout en la redoublant. Aussi la souveraineté apparaît-elle comme un mime ou un simulacre qui excèdent la maîtrise. La souveraineté ne peut être intégrée au sein du système : non relevable, incalculable, sans réserve, elle est la « tache aveugle » de la maîtrise, tache que Hegel aurait aperçue mais dont il n’aurait oser s’approcher. […] Il s’agit de cette liberté qui n’est attachée à rien et ne veut même pas se conserver, de l’immédiateté de la vie, du plaisir, de la consommation, de la dépense, de l’érotisme : du corps en somme[18].
Hegel est ainsi retourné contre lui-même[19]. Le détachement absolu n’est possible qu’à condition de se détacher de la dialectique, de soustraire le corps à l’emprise de la dialectique, d’en faire une vie « hors de soi » à laquelle il est devenu impossible de s’attacher.
L’un des intérêts de l’analyse de C. Malabou tient alors à ce qu’elle permet de situer clairement la lecture butlérienne de la section « Domination et servitude » par rapport à ces deux interprétations concurrentes de Hegel (celles de Kojève et de Bataille) qui, si elles posent toutes deux le problème du détachement absolu, y apportent des solutions divergentes (détachement conditionnel ou souveraineté). Comme nous l’avons rappelé pour commencer, J. Butler s’attarde longuement dans La Vie psychique du pouvoir sur les effets paradoxaux que produit la dialectique de la domination et de la servitude sur l’esclave et sur son rapport au corps. En se substituant au maître, qui lui délègue tacitement son corps pour en jouir (« Sois mon corps »), l’esclave ne voit pas son corps métamorphosé en corps spirituel, essentiel et symbolique ; il ne manifeste pas non plus, contre les limites d’une maîtrise conditionnelle, l’excès transgressif d’une souveraineté. Il découvre sa finitude : « La substitution des corps révèle à l’esclave le caractère insubstituable de sa mortalité. […] La substitution s’achève dans l’insubstituabilité »[20]. La découverte de cette finitude « insubstituable », intériorisée au cours d’un procès de travail qui est pour l’esclave un procès d’effacement de ses propres traces, ne correspond pourtant pas à un quelconque repli souverain sur soi. Elle coïncide plutôt avec « un attachement à soi, au « propre », au caractère insubstituable de sa propre vie »[21], en tant qu’il est mis en jeu, et en échec, dans la substitution des corps du maître et de l’esclave. « Sois mon corps » n’est pas tant alors la formule du détachement accompli du maître à l’égard de son propre corps, que l’indice de ce reste d’attachement que l’esclave lui-même finit par intérioriser – tout en le déniant, c’est-à-dire en lui donnant la forme d’un détachement : ce qui aboutit à faire de la conscience servile une conscience malheureuse : une conscience divisée entre attachement et détachement.
Or, il est remarquable que dans le propre travail de J. Butler cette figure hégélienne de la conscience malheureuse trouve un prolongement inattendu dans la théorie foucaldienne de l’assujettissement qui en reprend l’orientation paradoxale[22]. L’assujettissement ne s’entend pas en effet comme la soumission à la domination unilatérale d’un « pouvoir » externe, répressif, mais il suppose l’attachement à ce qui, dans cet assujettissement même, contribue à la subjectivation, c’est-à-dire au façonnement du soi. Attachement à soi et assujettissement vont donc de pair[23]. Dans un premier temps, cette lecture hégélienne de Foucault semble trouver sa propre limite dans une lecture foucaldienne de Hegel dont J. Butler reconstitue la trame. Celle-ci revient à mettre l’accent sur le caractère productif de la répression qui « engendre les plaisirs et désirs qu’elle cherche justement à réguler »[24]. Une telle dynamique d’auto-régulation ouvre alors la perspective d’une résistance et donc d’un nouveau type de détachement au sein même de l’assujettissement :
Chaque modalité de l’attachement, de l’assujettissement corporel se doublerait d’une modalité de plaisir, de détachement du corps – le détachement jouissif répondant ainsi trait pour trait à l’attachement contraignant. Ce détachement coïncide avec la multiplicité irréductible des pratiques de plaisirs, c’est-à-dire d’abord avec l’impossibilité d’unifier ces pratiques par une synthèse, quelle qu’elle soit, le sexe ou le corps[25].
La résistance paraît donc s’inscrire comme excès toujours possible « des corps et des plaisirs » par rapport aux objectifs régulateurs en vue desquels ils ont pourtant été produits[26]. Mais tel n’est pas le dernier mot de la lecture hégélienne de Foucault que J. Butler propose dans La Vie psychique du pouvoir. En effet, la perspective d’un détachement jouissif mérite elle-même d’être rapportée à celle d’un réattachement paradoxal à la régulation en tant, justement, qu’elle produit la possibilité du plaisir : un tel détachement « produit un attachement supplémentaire à la règle puisque sans règle pas de plaisir »[27]. On ne saurait mieux dire que le détachement, chez Foucault (comme au fond chez Kojève et chez Bataille), reste impossible à accomplir autrement que sous la forme d’un « attachement obstiné au détachement »[28] – attachement d’autant plus obstiné que ce détachement est sans cesse mis en échec.
A moins que, comme le suggère C. Malabou à la fin de son essai, cette structure paradoxale de l’attachement au détachement ne trouve chez Hegel lui-même sa « relève » dialectique lorsque les expériences (malheureuses) de la conscience débouchent finalement sur son « libre désaisissement » (« Aufgeben », abandon) au profit de l’Esprit, cette figure du soi anonyme qui entretient un rapport libre et « détaché », infini, à l’Absolu. La vérité du détachement se trouverait ainsi dans la dissolution du « moi ». « Détache-moi ! » s’entend alors comme l’injonction qui est faite à l’Esprit de s’accomplir comme (libre) détachement du moi. Reste à savoir toutefois si cette injonction ne masque pas elle-même une nouvelle forme d’attachement : attachement à l’ab-solu – attachement au détachement donc ?
*
La lecture que Judith Butler propose de La Phénoménologie dans son essai reprend cette question centrale de l’attachement et du détachement mais en la posant à un tout autre niveau et, en réalité, en revenant au point de départ « phénoménologique » de la dialectique du maître et de l’esclave[29]. J. Butler montre notamment que le face à face entre deux consciences qui inaugure cette dialectique sur fond de lutte pour la reconnaissance présuppose en quelque sorte des formes primordiales d’attachement à la vie dont elle cherche à analyser à la fois la constitution et le développement paradoxal.
« Que signifie être lié à un autre ? »[30]. Cette interrogation sur laquelle s’ouvre la réflexion de J. Butler paraît d’abord liée au scandale de l’existence de l’autre, c’est-à-dire d’une autre conscience qui est à la fois moi et autre que moi : le même et l’autre, ici et là. Pourtant, Judith Butler souligne que « l’apparition de l’autre est un « scandale » pour une certaine manière de penser qui tient pour assurée que la certitude du « je » est fondée dans son existence déterminée et spécifique – position qui sous-entend également que le corps propre est le fondement de tout type de certitude que le « je » peut avoir de lui-même »[31]. Or, que se passe-t-il si, au lieu de présupposer le moi et l’autre comme deux entités ontologiquement distinctes, dotées chacune d’un corps propre, et dont la mise en relation intervient de manière seconde, on cherche, comme le propose Hegel lui-même, à rendre compte du processus relationnel immanent à partir duquel la conscience « prend forme » et, en prenant forme, prend conscience de son propre redoublement ? Et qu’implique cette « formation » de la conscience quant à son attachement à soi ? Ces questions donnent lieu, dans l’analyse de Judith Butler, à un double mouvement de reconstruction du texte hégélien.
Dans un premier temps, l’attention se porte vers les passages qui précèdent « Domination et servitude » (passages consacrés à la « chose » et au « phénomène ») et dont J. Butler retient principalement l’articulation entre forme et vie. Si en un sens la forme est vivante, c’est parce qu’elle n’est pas auto-subsistante et statique, donnée une fois pour toutes, mais plutôt produite au cours d’un processus de différenciation temporelle et spatiale qui permet de la caractériser dans son mode d’être relationnel :
Un processus temporel ainsi qu’un ensemble de relations semblent être à l’œuvre dans la « forme », si bien qu’il faut penser les interstices entre les formes comme partie intégrante de ce qui définit la forme elle-même[32].
Cette dynamique relationnelle des formes s’inscrit alors au sein de la Vie, ou pour parler comme Hegel, dans l’élément de la Vie, où vient à s’exprimer la tension constitutive de la forme, à la fois finie, particulière en tant qu’existence spatio-temporelle déterminée et portée au-delà d’elle-même par le mouvement infini d’une perpétuelle trans-formation (plus précisément même d’une relation transformatrice entre les formes). Il n’y a pas de vie sans forme (déterminée), mais pas de forme sans vie (c’est-à-dire sans le « mouvement infini de la vie qui confère la forme et la dissout en général »[33]). Cette notion d’un enveloppement réciproque entre la vie des formes et les formes de vie fait écho à l’idée d’« hétéro-affection » suggérée par Catherine Malabou à la fin de son propre essai. Autrement dit, ce que le concept de vie rend impossible, c’est l’attachement à soi, comme attachement à sa vie propre : comme le dit encore Judith Butler dans le dialogue qui suit, « être en vie, être attaché à la vie signifierait être attaché à sa propre dissolution ou découvrir que la vie n’est jamais exclusivement la nôtre »[34].
Dans ces conditions, l’entrée en scène d’une « vie indépendante », d’une forme-« je » attachée à sa « vie indépendante » et revendiquant d’être certaine d’elle-même (donc détachée du mouvement de la Vie), constitue un bouleversement dont l’ensemble du chapitre « Domination et servitude » aura à mesurer les enjeux et à tirer les conséquences. D’une part, cette certitude soi est en butte à la substituabilité et à la finitude de toute forme déterminée : « le « je » n’est qu’une forme parmi d’autres qui vient à l’être et disparaît »[35]. D’autre part, et par conséquent, son indépendance est problématique, pas du tout certaine et encore moins certaine d’elle-même. Elle doit être reconnue à la fois par et contre un autre « je » - dont dépend en un sens cette indépendance mais qui renvoie aussi au « je » l’image de sa propre substituabilité : « Le « je » est redoublé et, en tant que tel, il est désormais rivé à une scène de désir et de peur : il a besoin de l’autre mais il a également besoin de son anéantissement »[36]. Le redoublement est donc à la fois condition de l’accès à la certitude de soi et impossibilité d’échapper à sa propre substituabilité – sauf à détruire l’autre et à prendre sa place. Il apparaît alors qu’il y a une vie sociale des formes, d’ordre conflictuel et même destructeur, qui se déploie de manière paradoxale : « La condition de la substituabilité n’est autre que le non-substituable. L’un ne peut chercher à affirmer sa singularité [donc son caractère non-substituable] qu’en se substituant à l’autre »[37]. Dans quelle mesure ce paradoxe éclaire-t-il alors la dialectique du maître et de l’esclave ?
Il l’éclaire dans la mesure où, à travers le jeu de la substitution (infinie) et de la finitude, c’est le corps qui, sans être vraiment nommé, fait son apparition. Le corps définit en effet une forme singulière qui, en tant que forme de vie ou forme vivante, est structurellement prise dans le mouvement de la Vie qui la met en relation avec d’autres formes : « Pour qu’un corps soit un corps, il doit être lié à un autre corps »[38]. Ce « lien », cette « contrainte d’être lié [the bind of being bound] »[39], marque une forme d’attachement à la vie - sur fond de vulnérabilité et de dépendance - que les consciences en lutte cherchent à effacer afin de faire triompher leur singularité et leur certitude de soi – alors même que cette singularité se fonde sur la substituabilité des formes. Dans ces conditions, le « maître » est celui qui se livre au tour de passe-passe que nous avons rappelé pour commencer et que Butler analyse pour finir dans les termes d’« une instrumentalisation spécifique de la substituabilité. « Sois mon corps, toi » »[40] : cette formule est donc chargée d’équivocité. Elle signifie bien sûr l’acte de délégation par lequel le maître se place en position de maîtrise (de détachement assumé). Mais elle signifie aussi que cette maîtrise n’est que et ne peut jamais être que partielle – ou substitutive : ce corps que le maître délègue en un sens lui appartient (comment déléguer ce sur quoi on n’a pas la main ?) et en un autre sens ne lui appartient pas en « propre » puisque la condition du corps est d’être « toujours déjà délégué, compris comme une forme parmi d’autres, hors de lui-même, lié à d’autres corps »[41]. C’est cette liaison qui rend au fond le corps inévacuable ou du moins son évacuation toujours partielle : qui rend donc le détachement absolu du corps impossible et qui fonde sur cette impossibilité même la vulnérabilité de toute vie. Mais il est possible d’ajouter que c’est cette liaison qui rend aussi l’attachement à soi impossible puisque le corps vivant n’exprime sa singularité que sur fond de substituabilité, c’est-à-dire sur fond de persistance (ou de persévérance dans l’être) redoublée : sois mon corps, toi, avec et par cet autre corps qui n’est le tien qu’à condition d’être le substitut du mien, qu’à condition d’être comme le mien. La dialectique du maître et de l’esclave forme ainsi « la répétition, sans fin et sans issue, de l’évacuation du corps au sein même de sa persistance »[42]. Elle est la scène où se joue un détachement dans l’attachement, une persévérance dans le détachement, toujours en cours, jamais accompli.
*
« Que signifie être lié à un autre ? » se demande Judith Butler. Comme on l’a vu à travers la présentation des deux essais qui composent Sois mon corps, cette question trouve dans La Phénoménologie hégélienne l’un de ses lieux de problématisation privilégiés. Car dès lors qu’est mise en lumière la dynamique relationnelle qui à la fois attache les formes vivantes les unes aux autres et les détache les unes des autres, il apparaît que l’ensemble des paradoxes de l’injonction « Sois mon corps » se concentrent dans ce que Judith Butler nomme pour finir la « vie du corps », laquelle consiste « dans le mouvement contraire d’une propulsion vers [la conservation] et loin de la conservation »[43]. Le corps n’est donc pas un « site » stable où l’on peut facilement être ou se maintenir dans l’être – bref, se « tenir ». Il est plutôt cette zone de « rencontre et de répulsion »[44] où se mesurent l’une à l’autre la précarité de la vie et sa persistance : la négativité de la mort et le désir de vivre. Ce qui peut se passer dans cette « zone » est relativement incertain : c’est pourquoi la « vie du corps » suscite à la fois l’inquiétude et l’espoir.
En rapportant d’une certaine façon la dialectique du maître et de l’esclave à ses présupposés ontologiques, J. Butler ne vise nullement à en atténuer la portée critique. Elle invite au contraire à penser que cette dialectique met en jeu non pas tant des figures sociales préétablies et fondamentalement antagoniques (comme semblait le soutenir Kojève) que des êtres humains, incarnés et vivants, dont la vulnérabilité même est source potentielle de violence - lorsque cette condition ontologique d’interdépendance est déniée et masquée par l’affirmation d’un détachement illusoire -, autant que de reconnaissance réciproque - lorsque cette vulnérabilité devient une condition d’existence partagée[45]. Nous voyons alors apparaître le bénéfice de la torsion que J. Butler inflige dans son essai à l’interprétation kojévienne des passages de la Phénoménologie consacrés à la figure de la domination/servitude. Car, au lieu d’y voir l’expression d’une pure négativité, inscrite au cœur du désir et de la conscience de soi (qui n’accède à elle-même qu’à travers une histoire marquée par les luttes et par le travail), elle propose de souligner plutôt l’ambiguïté native de cette figure, marquée à la fois par une relation complexe et inévacuable à la vie du corps et par une exposition continue à la contingence historique – qui dessinent clairement les conditions et les limites de la puissance d’agir et de vivre de l’homme.
Article paru dans la revue en ligne Methodos, n°11/2011.
[1] Ce texte a été rédigé en avril 2010 à l’occasion de la venue de Judith Butler à l’université Lille 3, où elle a prononcé une conférence intitulée « Précarité, deuil et reconnaissabilité de la vie ». La présentation que j’ai proposée de Sois mon corps lors d’un atelier de travail organisé avec les étudiants de Master de l’UFR de Philosophie et des doctorants de l’UMR « Savoirs, textes, langage » a donné lieu à une belle discussion et à un échange vivant avec J. Butler. Que celle-ci en soit ici remerciée.
[2] On pense notamment aux travaux d’Axel Honneth autour de la thématique de la reconnaissance (voir en particulier La Lutte pour la reconnaissance, Paris, Cerf, 2000). Mais il faut signaler également et dans une tout autre perspective les travaux de Catherine Malabou autour du concept de « plasticité » (voir L'Avenir de Hegel : Plasticité, Temporalité, Dialectique, Paris, Vrin, 1996). On trouve un panorama complet des usages et des problèmes liés à la théorie hégélienne de la reconnaissance dans l'article de Patrice Canivez, "Pathologies of Recognition", Philosophy and Social Criticism, 37(8)/2011, p.851-887.
[3] Judith Butler, Catherine Malabou, Sois mon corps. Une lecture contemporaine de la domination et de la servitude chez Hegel, Paris, Bayard, 2010 (ensuite cité SMC).
[4] Les cours de Kojève ont été édités par l’un de ses auditeurs assidus, Raymond Queneau, sous le titre Introduction à la lecture de Hegel (Paris, Gallimard, 1947). Notons que dans cette édition, le « commentaire parlé » du chapitre consacré à « Domination et servitude » était placé en tête du volume, à la manière d’un exergue.
[5] Jean Hyppolite a fait paraître en 1941 chez Aubier la première traduction complète de la Phénoménologie de l’esprit, suivie en 1946 de la publication de sa thèse consacrée à Genèse et structure de la Phénoménologie de l’esprit.
[6] Voir à ce sujet la mise au point que j’ai proposée au début de mon intervention sur « Hégélianisme et French Theory » dans le cadre du groupe de travail « La philosophie au sens large » animé par Pierre Macherey (séance du 23/04/2008) : http://stl.recherche.univ-lille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/macherey20072008/sabot_butler_23042008.html.
[7] Judith Butler, La Vie psychique du pouvoir. L’assujettissement en théories [1997], tr. fçse B. Matthieussent, Paris, Editions Léo Scheer, « Non & Non », 2002 (ensuite cité VPP), chapitre 1 : « Attachement obstiné, assujettissement corporel ». Notons que ce texte canonique de la dialectique maître/esclave forme également le point de départ de son premier ouvrage Sujets du désir. Réflexions hégéliennes en France au XXe siècle [1987], tr. frçse P. Sabot, Paris, PUF, « Pratiques théoriques », 2011. Elle y revient également dans Le Récit de soi [2005] (tr. frçse B. Ambroise & V. Aucoututier, Paris, PUF, « Pratiques théoriques », 2007) où l’accent est mis cependant davantage sur la thématique de la reconnaissance, renouvelée en particulier à partir des travaux d’Axel Honneth notamment. Sur la reprise butlérienne de cette thématique de la reconnaissance, voir Christophe Bouton, « Les apories de la lutte pour la reconnaissance. Hegel, Kojève, Butler », in F. Brugère & G. le Blanc, Judith Butler. Trouble dans le sujet, trouble dans les normes (Paris, PUF, « Débats philosophiques », 2009, p.35-67) et Kim Ong-Van-Cung, « Vulnérabilité et reconnaissance. Honneth et Butler » (Archives de Philosophie n°73/2010, p.1-23).
[8] VPP, p.67.
[9] L’interprétation que Butler propose de la figure de la domination/servitude dans La Vie psychique du pouvoir est analysée en détail par Franck Fischbach dans Sans objet. Capitalisme, subjectivité, aliénation, Paris, Vrin, « Problèmes & Controverses », 2009 (Deuxième partie, chapitre 1 : « « Sois mon corps à ma place ». Judith Butler lectrice de Hegel »).
[10] VPP, p.76.
[11] Ibidem. Cité par C. Malabou in SMC, p.37.
[12] VPP, p.94.
[13] Voir VPP, p.65 et aussi C. Bouton, art. cit., p.51-52.
[14] SMC, p.8.
[15] SMC, p.9.
[16] SMC, p.14.
[17] SMC, p.17.
[18] SMC, p.31.
[19] Catherine Malabou lit ici Bataille à travers Derrida. Voir en particulier « De l’économie générale à l’économie restreinte. Un hégélianisme sans réserve », in L’Ecriture et la différence, Paris, Minuit, 1972, p.369-407.
[20] SMC, p.38.
[21] SMC, p.39.
[22] Ainsi que le souligne C. Malabou, « Butler considère que le concept foucaldien d’assujettissement est préfiguré dans l’analyse hégélienne de l’auto-asservissement du serviteur qui achève la section « Domination et servitude » » (SMC, p.43).
[23] Sur ce rapport entre attachement et assujettissement, voir en particulier les analyses proposées par Guillaume le Blanc dans La Pensée Foucault (Paris, Ellipses, « Philo », 2006, chap. « La vie sociale de l’assujettissement ») et par Franck Fischbach, op. cit., p.126.
[24] VPP, p.99.
[25] SMC, p.45.
[26] Dans Trouble dans le genre, J. Butler objecte à Foucault le statut problématique des « corps » et des « plaisirs » auxquels est réservé un sort particulier à la fin de la Volonté de savoir (en alternative à la « monarchie du sexe ») ainsi que dans l’introduction à l’édition américaine mémoires d’Herculine Barbin (publiée dans la revue Arcadie en 1980 sous le titre « Le vrai sexe » in Dits et écrits, Paris, Gallimard, 1994, IV, n°287). Selon Butler, ce que Foucault interprète dans le récit d’Herculine Barbin comme la promesse d’une sexualité irréductible aux catégorisations de genre, participe plutôt de la plasticité de ces catégorisations, non substantielles, qui ne renvoient pas en tout cas au sexe comme à leur cause univoque, produisant toujours les mêmes effets, et marquant les corps invariablement de la même manière : « L’anatomie de Herculine ne tombe pas en dehors des catégories de sexe, mais elle confond et redistribue les éléments constitutifs de ces catégories ; en réalité, le libre jeu des attributs a pour effet de révéler le caractère illusoire du sexe comme substrat d’une substance durable auquel ces différents attributs sont censés s’appliquer » (Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité [1990], tr. frçse C. Kraus, Paris, La Découverte, 2005, p.208). Voir également la mise au point plus récente dans « Reconsidérer « les corps et le plaisirs » » [2001], in Incidence, n°4-5/2008-2009, p.91-116.
[27] SMC, p.46-47.
[28] SMC, p.48.
[29] On trouve une démarche analogue dans le premier chapitre de Sujets du désir (« Désir, rhétorique et reconnaissance dans la Phénoménologie de l’esprit de Hegel ») lorsque J. Butler cherche à rendre compte de l’émergence du désir dans la phénoménologie hégélienne.
[30] SMC, p.57.
[31] SMC, p.61.
[32] SMC, p.67-68.
[33] SMC, p.70-71.
[34] SMC, p.101.
[35] SMC, p.73.
[36] SMC, p.74.
[37] SMC, p.77.
[38] SMC, p.80. Ce thème de l’interdépendance des corps forme le principe d’une ontologie sociale du corps que Butler développe notamment dans l’introduction de Ce qui fait une vie. Essai sur la violence, la guerre et le deuil (tr. frçse J. Marelli, Paris, La Découverte, « Zones », 2010) ou encore dans cet entretien paru en 2011 dans la revue Critique : « Je pense que lorsque nous comprenons le corps comme une structure extatique, comme nécessairement hors de lui-même, il apparaît comme étant à la fois exposé à la signification et aux sens sociaux, et lié, d’emblée, à un monde où il y a des autres, d’emblée dans une condition d’interdépendance » (« Le corps est hors de lui », Critique n°764-765/janvier-février 2011, p.83).
[39] SMC, p.84.
[40] SMC, p.81.
[41] SMC, p.82.
[42] SMC, p.84.
[43] SMC, p.101.
[44] Ibidem.
[45] « Il me semble que la précarité signifie la possible ruine de tout sujet, et qu’elle fournit aussi une base pour parvenir à une alliance entre des populations qui sont exposées différemment aux blessures et à la destruction. Ainsi, cette catégorie devrait-elle contribuer à une politique par delà l’identité » (« Le corps est hors de lui », entretien cité, p.84).


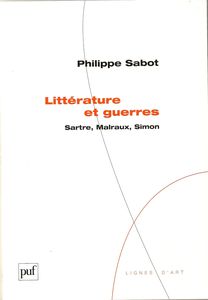




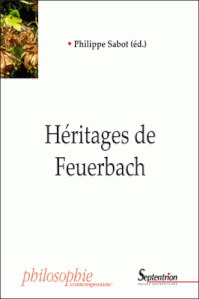








Les Queer readings d’Eve Kosofsky Sedgwick
A propos d’Epistémologie du placard (Amsterdam, trad. fr. M. Cervulle, 2008)
Epistémologie du placard constitue, à côté du texte-manifeste de Teresa de Lauretis « Théorie queer : sexualités lesbiennes et gaies. Une introduction »[1] et de Trouble dans le genre de Judith Butler (parus la même année, en 1990), l’un des textes fondateurs de ce courant de pensée qui a déferlé sur les campus américains au début des années 1990 sous le nom de « Queer Theory ». Pour aller vite, on dira que la théorie « queer » s’est développée sur fond d’activisme politique et associatif (particulièrement virulent avec l’apparition du SIDA), à la fois comme une voie de contestation de l’hétérosexisme homophobe et comme une réflexion sur les effets du communautarisme gay des années 1980, issu du combat juridique et politique pour la reconnaissance d’une identité homosexuelle dépathologisée. Ce que la théorie « queer » s’est donnée alors pour « objet » n’est donc pas une positivité assignable (comme l’homosexualité par exemple) à décrire et à analyser dans ses différentes manifestations, mais c’est plutôt le mouvement par lequel des binarismes sexuels (homo-/hétéro-sexuel) ou des identités de genre (homme/femme) sont défamiliarisés, troublés, entraînés dans un processus de dissolution, révélant qu’au fond, en matière de sexualité, il n’y a pas d’identités stables, essentielles ou substantielles, mais seulement des « identités » de position, mettant en question depuis les marges qu’elles occupent sur l’échiquier des sexualités possibles le paradigme hétéronormatif de la culture occidentale[2].
Une telle opération de « queerisation » des identités se trouve notamment à l’œuvre dans les premiers travaux de Judith Butler sur le genre (notamment Trouble dans le genre, mais aussi Ces corps qui comptent[3]). Pour Butler en effet, le genre est à concevoir non pas comme une détermination substantielle du sujet mais plutôt comme une production « performative »[4], ce qui implique une instabilité radicale puisque d’une part cette identité mal assurée doit sans cesse se répéter pour accéder à un semblant de normalité, et puisque d’autre part tout énoncé performatif, du fait de son itérabilité, peut être recontextualisé de manière imprévisible – ce qui est le cas avec la citation parodique des normes de féminité dans les spectacles de drag-queens, ou encore avec le détournement et la resignification de l’insulte « Queer ! » par les gays new-yorkais de Queer Nation. Le caractère historique du processus performatif ouvre ainsi la possibilité d’une lutte politique fondée sur la subversion de l’identité de genre.
C’est une démarche du même ordre, consistant à jeter le trouble dans la
répartition des catégories d’identification sexuelle du « sujet », que propose à son tour Eve Kosofsky Sedgwick dans son Epistémologie du placard. Elle entreprend notamment
d’étudier la sexualité à partir d’un schéma interprétatif qu’elle appelle le « binarisme minorisant/universalisant » (EP, p.60). Il s’agit de savoir si la question de la définition de
l’homo/hétéro-sexualité « n’est une question importante que pour une minorité homosexuelle, réduite, distincte et relativement fixe », ou si « cette question est d’une importance
constante et déterminante pour la vie de toute personne sur le continuum des sexualités » (EP, p.24). Selon la première perspective, l’homosexuel se définit à partir d’une norme
sexuelle majoritaire par rapport à laquelle il se singularise et s’identifie tout en s’isolant. Selon la seconde perspective, l’homosexualité ne se définit plus dans les marges d’un comportement
sexuel hétéronormé mais représente plutôt une manière de vivre sa sexualité parmi d’autres, avec laquelle compose nécessairement l’hétérosexualité dans une indétermination et une tension propres
à susciter l’inquiétude et même, comme on va le voir, la « panique ». Loin de trancher a priori pour l’une ou l’autre de ces perspectives, l’objectif de Sedgwick, tel qu’il est
présenté dès l’introduction de son ouvrage, est plutôt de prendre comme fil conducteur de ses analyses une certaine « crise définitionnelle chronique de l’homo/hétéro-sexualité »,
c’est-à-dire une crise dans la manière de définir la sexualité entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, - crise qui découle du caractère indécidable de ce
binarisme, et qui affecte non seulement la détermination de l’homosexualité (comme sexualité liée à un choix d’objet sexuel ou à un type d’actes singuliers) mais aussi la stabilité de la relation
entre homosexualité et hétérosexualité au sein de la culture occidentale moderne.
Avant d’entrer dans le détail de ses analyses et de préciser leurs enjeux, il faut en souligner encore deux traits caractéristiques. D’abord, l’investigation d’Eve Kosofsky Sedgwick trouve son point de départ dans la généalogie du « dispositif de sexualité » proposé par Foucault dans La Volonté de savoir, et singulièrement dans l’analyse de la modification historique qui affecte le statut de l’homosexualité à la fin du XIXe siècle : selon Foucault, « la catégorie psychologique, psychiatrique, médicale de l’homosexualité s’est constituée du jour où on l’a caractérisée […] moins par un type de relations sexuelles que par une certaine qualité de la sensibilité sexuelle, une certaine manière d’intervertir en soi le masculin et le féminin » (La Volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p.59). La naissance du sujet homosexuel, de l’homosexuel comme sujet inverti du point de vue de son « genre », s’accompagne de la mise en place de discours normatifs et objectivants, fondés sur le partage du normal (hétérosexuel) et de l’anormal (homosexuel), et qui visent à énoncer la vérité du genre et surtout à contenir cette vérité dans les limites d’un binarisme homo/hétéro-sexuel instrumentalisé dans le cadre du contrôle social des populations.
C’est ici qu’apparaît le second trait caractéristique de la démarche de
Sedgwick. Car celle-ci consiste justement à déconstruire cette « dichotomie hétérosexuel/homosexuel, telle qu’elle a émergé dans le discours occidental du siècle dernier » (EP, p.54),
en prenant appui sur les œuvres d’auteurs comme Melville, Wilde, James ou Proust qui selon elle contribuent à la fois à forger une certaine image de l’homosexualité et de l’homosexuel (une image
identifiable à certains traits singuliers selon la perspective minorisante) et à troubler cette image en ambiguïsant sur le plan narratif et thématique les relations entre hétérosexualité et
homosexualité (en jouant donc d’une perspective universalisante). Dans les textes étudiés par Sedgwick tout au long de son travail s’opère ainsi à vif une déconstruction des stéréotypes produits
au même moment dans le discours taxinomique faisant de l’homosexuel dans une « espèce » déterminée (EP, p.31). Les « Queer readings in Fiction » de Sedgwick (pour
reprendre le titre d’un ouvrage collectif qu’elle a dirigé[5]) reposent par conséquent sur l’idée que la littérature ne constitue pas
simplement un terrain d’objectivation des stéréotypes stigmatisants produits dans le cadre du positivisme juridique, médical, psychiatrique et du binarisme homo/hétéro-sexuel qui soutient le
« dispositif de sexualité » propre à la modernité ; mais qu’elle forme plutôt la matrice d’une réappropriation secondaire, d’une resignification déconstructive de ces stéréotypes
et de ce binarisme dont elle contribue à révéler les ambivalences et les tensions non-résolues.
Or, ces tensions issues de la crise définitionnelle de l’homo/hétéro-sexualité caractéristique de l’époque moderne selon Sedgwick se cristallisent pour une large part dans l’expérience du « placard » dont les textes littéraires et leurs lectures mettent en lumière la complexité et l’instabilité épistémologiques qui contamine par extension tout discours de vérité – non pas seulement le discours que le sujet tient sur lui-même (en exposant ou en réservant sa vérité) mais aussi certains des catégories centrales à partir desquels s’articule notre rapport au savoir (privé/public, secret/révélation, innocence/initiation…). Pour comprendre ce que recouvre cette « expérience du placard » et sa portée « épistémologique », un détour par la langue anglaise s’impose. La référence au « placard » (closet) renvoie ici aux expressions : « to come out of/to be out of the closet » - littéralement « sortir » ou « être hors du placard » et, de manière contextuelle, « dire publiquement que l’on est homosexuel » ou « afficher ouvertement son homosexualité ». Pour les homosexuels, l’expérience du placard paraît par conséquent adossée à une topologie binaire –in/out, dedans/dehors – qui renvoie au fait de révéler ou non son homosexualité à son entourage (famille, amis, collègues de travail).
Pourtant, les choses sont plus complexes, plus tordues (queer ?), et nécessitent qu’on réfléchisse de plus près à la structure épistémologique feuilletée qui sous-tend la révélation de soi impliquée par la sortie du placard. Car, comme l’observe Sedgwick, l’alternative simple du « dedans » et du « dehors » est trompeuse dans la mesure où elle ne recouvre pas une opposition tranchée entre ignorance et savoir, avec le passage orienté et irréversible de l’une à l’autre, du tu au su, mais qu’elle implique plutôt une économie du secret et de la révélation, qui suppose une recomposition permanente, en droit jamais achevée, du « placard » homosexuel :
Même celles et ceux qui sont out se trouvent confrontés quotidiennement à des interlocuteurs et interlocutrices à propos desquels ils ne savent pas s’ils savent ou non. De la même manière, il est tout aussi difficile de deviner pour un interlocuteur donné si, dans le cas où il saurait, ce savoir lui semblerait important ou non (EP, p.86).
On comprend que le problème épistémologique posé par la sortie du placard ne peut être envisagé indépendamment des rapports de pouvoir qui secrètement l’organisent et, simultanément, la limitent. Car le placard continue d’exercer sa contrainte même sur les homosexuels « out ». Le placard homosexuel constitue donc une structure mobile, potentiellement oppressive dans l’économie mixte de savoir, d’ignorance et de pouvoir qu’elle met en place. Comment faire la part de ce que nous savons (ou croyons savoir, ou croyons savoir qu’un autre sait) et de ce que nous ne savons pas (de ce que l’autre sait vraiment, ou de ce qu’il sait tout en refusant de le savoir et qu’il peut néanmoins utiliser contre nous) [6] ? Ces incertitudes, parfois lourdes de conséquences sur le plan de la vie personnelle ou professionnelle, attestent selon Sedgwick de l’indécision fondamentale qui affecte la définition de l’homo/hétéro-sexualité dans notre culture. Et ce sont justement ces incertitudes, ces résistances aussi (souvent suspectes : si je ne veux pas savoir, est-ce que je sais vraiment pourquoi et ce que je ne veux pas savoir ?) qu’elle cherche à traquer dans les textes littéraires qu’elle soumet à une lecture attentive et perverse, dans la perspective de mettre au jour leur propre « épistémologie du placard », c’est-à-dire la manière dont ils organisent autour de la figure (implicite ou explicite) de l’homosexuel toute une économie narrative et symbolique du soupçon et de la révélation dont les enjeux concernent au premier chef la définition de l’homo/hétéro-sexualité. Parmi les nombreuses analyses que propose l’ouvrage de Sedgwick, nous retiendrons par commodité et pour l’éclairage qu’elles apportent sur une manière « queer » de lire ou de « prendre » les textes littéraires[7], celles qui sont consacrées à La Bête dans la jungle de Henry James et à quelques passages d’A la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Ces analyses sont développées dans les chapitres IV et V d’Epistémologie du placard.
La lecture de James s’inscrit dans le cadre d’une réflexion sur ce que
Sedgwick appelle la « panique homosexuelle masculine » qui correspond à une dimension paranoïaque des relations entre hommes. Comme elle l’avait montré dans un précédent ouvrage[8] en s’appuyant sur les apports conjoints de l’anthropologie lévi-straussienne et
de la théorie girardienne de la mimesis, les formes d’homophobie qui se développent en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle ne visent pas seulement « une population
minoritaire émergente d’hommes distinctement homosexuels » mais ont pour enjeu « la régulation des liens homosociaux masculins qui structurent toute culture, toute culture publique ou
hétérosexuelle » (EP, p.195). Cela signifie que la socialité est une affaire d’hommes et que les hommes, pour asseoir leurs privilèges dans tous les domaines de la culture, doivent rester
entre eux, et même amplifier ou intensifier leurs relations « homosociales » : ce qui est le cas notamment dans l’échange des femmes où, comme le montre Sedgwick à partir de sa
relecture de Lévi-Strauss, il ne s’agit pas d’établir une relation entre un homme et une femme, mais « entre deux groupes d’hommes » pour lesquels la femme n’est qu’un objet d’échange
et non un des partenaires avec lequel cet échange a lieu. Or, cette intensification de l’homosocialité, envisagée comme le socle de la domination masculine, se paye d’une plus grande proximité
des hommes entre eux et de la diffusion corrélative d’une conception universalisante de l’homosexualité selon laquelle si les hommes restent entre eux, ils s’exposent au risque ou du moins au
soupçon de l’homosexualité : l’homophobie (comme mise au « placard » et comme minorisation violente de la « bête » homosexuelle) est ainsi une haine qui
s’étaye sur la crainte d’être soupçonné d’« en être ». Elle constitue à ce titre une réponse possible à cet état de panique endémique qui saisit les hommes lorsqu’ils se
trouvent soumis à la double contrainte de la « prescription du lien masculin le plus intime et de la proscription de l’homosexualité (qui est singulièrement liée à la première) » (EP,
p.197).
Mais Sedgwick montre également que cette double contrainte trouve dans la littérature anglo-saxonne du XIXe siècle et du début du XXe siècle des formes d’expression distinctes. L’une de ces formes d’expression correspond au développement de la littérature gothique où Sedgwick décèle des modes de construction littéraire de la masculinité qui se déploient, non sans une certaine violence, contre le déploiement corrélatif de significations homosexuelles. Dans nombre de romans gothiques relevant de ce qu’elle appelle le « Gothique paranoïaque », il est possible de repérer une même structure narrative : « un héros masculin entretient une relation étroite, habituellement meurtrière, avec une autre figure masculine, son « double », pour qui il semble être mentalement transparent » (EP, p.197 note) - c’est le cas par exemple dans Frankenstein de Mary Shelley étudié dans Between Men. Le schème de la panique homosexuelle masculine trouve toutefois de tout autres formes d’expression dans la littérature victorienne et chez des auteurs comme Thackeray, Du Maurier et James, où, loin du déchaînement gothique de la violence homophobe, il fait plutôt l’objet d’une récupération sous la forme d’une « domestication » - on pourrait dire d’une placardisation en règle – qu’incarne alors la figure romanesque du « célibataire ».
Ainsi, dans la fiction de James, La Bête dans la jungle, le personnage principal, John Marcher, est décrit comme un personnage discret, voire secret : la seule chose ou presque qu’on sait de lui, c’est justement qu’il a un secret, une destinée secrète dont la fin du récit laisse croire qu’il s’agit (simplement) d’une promotion du héros comme héros hétérosexuel, enfin capable d’entrer en relation avec May Bartram, le personnage féminin qui accompagne à distance sa destinée : « L’aimer, voilà quelle eût été l’issue ; alors, alors, il aurait vécu », se dit John Marcher à la toute fin du récit, lorsqu’il est trop tard et que May est morte et enterrée. Du point de vue de Sedgwick, il ne s’agit pourtant pas d’une banale romance à l’eau de rose, d’un drame de l’amour impossible brisé par la mort de l’un des deux partenaires. Car selon elle, le personnage de Marcher le célibataire est loin d’être transparent et son secret, non dévoilé mais dont il sait que May le connaît, constitue « le placard d’un secret homosexuel » - non pas, comme y insiste Sedgwick, le placard dans lequel se cache un homosexuel (puisque rien ne nous permet de savoir clairement si Marcher est ou non homosexuel) mais « le placard selon lequel on imagine un secret homosexuel » (EP, p.214). Or, si Marcher vit comme une personne au placard, s’il vit comme s’il était homosexuel, en même temps – panique oblige – il fait tout pour protéger ce secret dont il ne sait rien d’autre que ce que lui en laisse supposer son incapacité à entrer vraiment en relation avec May, et il se sert d’elle pour jouer le jeu de l’hétérosexualité obligatoire :
Quel que soit le contenu de ce secret interne, c’est un secret dont la protection requiert de Marcher une performance hétérosexuelle consciente de n’être qu’une façade : « Vous m’aidez, dit-il à May, à passer pour un homme comme les autres… » (EP, p.215).
Le schéma de domestication de la panique homosexuelle auquel obéit l’anti-héros de James sous la pression de l’hétéronormativité sociale correspond donc à un renforcement paranoïaque du placard : paralysé par son propre secret, qu’il ne partage avec May Bartram que sous la forme inversé d’un fantasme hétérosexuel, John Marcher entraîne celle qui partage son secret dans sa propre méconnaissance. En jouant le jeu de l’hétérosexualité obligatoire, May dissimule le placard de John à des yeux étrangers, potentiellement homophobes. Son savoir (à elle) n’ébranle pas son ignorance (à lui) mais la renforce paradoxalement en en modifiant la nature :
Le « progrès » de Marcher auquel [May] assiste est celui qu’impose la culture avec la plus grande insistance : son progrès d’une ignorance abyssale et épineuse à propos de ses propres possibilités homosexuelles à une ignorance aboutie, rationalisée, acceptée et totalement dissimulée (EP, p.216).
Selon Sedgwick, la culture se fonde bien sur cette « loi masculine d’ignorance de soi » (EP, p.217) qui définit donc la structure épistémologique du placard jamesien dans La Bête dans la jungle. Le « secret » qui était annoncé au début de son récit par James ne sera finalement jamais révélé, et l’engagement sentimental et sexuel avec May Bartram reste à la fois attendu – dès lors qu’il apparaît obligatoire – et toujours repoussé – dans la mesure où John Marcher est définitivement incapable de dire et d’identifier ses propres désirs : « La prophétie que fait May à John (« A présent, vous ne saurez jamais ») finit donc par se réaliser » (EP, p.219). « Vous ne saurez jamais »… que ce que vous prenez pour la norme (l’amour hétérosexuel) ne relève que d’une obligation culturelle dont le pouvoir contraignant tient à l’ignorance dans laquelle elle tient ceux qui la mettent en œuvre, donc à l’ignorance de cette ignorance. La possibilité d’un savoir (et même d’un se savoir) homosexuel est par conséquent retournée en la nécessité d’une ignorance valant comme la placardisation de ce savoir dont la tombe de May Bartram constitue une métaphore commode.
Dans l’étude conclusive d’Epistémologie du placard, consacrée à La Recherche proustienne, Eve Kosofsky Sedgwick propose d’identifier un effet supplémentaire de la structure du placard. Être au placard peut en effet signifier à la fois posséder un secret pour celui qui y est ou qui s’y met (c’est le cas de John Marcher dans la fiction de James), et donner le « spectacle du placard » pour celles et ceux qui n’y sont pas : c’est alors la dimension de l’implicite qui est fondamentale, et qui structure les relations des homosexuels avec leur entourage. Pour manifester les pouvoirs déstabilisants de cette dialectique du placard-spectacle (ou « placard de verre »), Sedgwick s’intéresse à la configuration sexuelle que Proust élabore à partir de deux personnages (Charlus et Albertine) présentant deux versions de l’homosexualité, qui ont néanmoins « en commun […] une sorte d’inclinaison asymétrique vers le féminin : Charlus est féminisé par son désir homosexuel, tout comme Albertine qui est féminisée par le sien (dans la mesure où son genre constitue un terme actif de sa sexualité) » (EP, p.240). La conséquence de cette commune « inclinaison asymétrique vers le féminin », c’est qu’Albertine n’a rien à cacher (être « féminine » pour une femme, cela n’a rien d’anormal), alors que Charlus s’efforce de dissimuler son « inversion » de genre qu’il porte néanmoins comme un stigmate au milieu du monde. Ainsi, le cauchemar de Charlus tient à ce qu’il est persuadé que personne n’est « fixé sur son compte » (selon son expression, Sodome et Gomorrhe, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1988, p.1042 - cité ensuite SG) alors que, tout au long de la Recherche, il ne cesse d’être vu et identifié comme un homosexuel par les autres (en particulier par les Verdurin qui multiplient les sous-entendus concernant les penchants jugés discutables et pourtant à bien des égards fascinants du baron).
La Recherche se structure ainsi autour du « spectacle du placard », c’est-à-dire du regard porté sur ce « secret de Polichinelle » qui, censé n’être connu de personne (selon Charlus), est néanmoins connu de tous, et d’abord du narrateur lui-même dont Sedgwick interroge longuement la position spectatrice et même scrutatrice, non dénuée d’ambiguïté et de conséquences quant à la structure épistémologique du placard proustien qui s’ordonne à la formule : « It takes one to know one » - « il faut en être pour savoir ». Sedgwick insiste en effet sur le fait que le lecteur est en quelque sorte placé en position de voyeur et de savoir ce qu’il en est (de Charlus) par la mise en scène du « spectacle du placard » dans une narration qui semble elle-même émaner de ce que Sedgwick appelle le « point de vue du placard ». Ce point de vue n’est pas seulement celui de Charlus, c’est-à-dire ce point de vue vécu sur un secret qui ignore que ce secret n’est qu’un « secret de polichinelle » pour les autres. Mais il s’agit également de ce point de vue externe et interne à la fois selon lequel narrateur et lecteur se retrouvent ensemble dans une expérience voyeuriste déstabilisatrice : peut-on voir et savoir ce que l’on sait et voit sans « en être » ? Ainsi, après que Jupien s’est exclamé à propos de Charlus : « Vous en avez un gros pétard ! », le narrateur-spectateur parvient à cette révélation surprenante : « Je comprenais maintenant pourquoi tout à l’heure, quand je l’avais vu sortir de chez Mme de Villeparisis, j’avais pu trouver que M. de Charlus était une femme : c’en était une ! » (SG, p.17-18). Une quoi ? Non pas sans doute une « vraie » femme, c’est-à-dire une femme du genre féminin ; mais une espèce de « femme », une femme d’un genre spécial (« queer »), ou encore ce type d’homme « inverti » dont le genre féminin s’atteste suffisamment aux yeux du narrateur par le fait que, comme les femmes, il aime les hommes ! Les efforts de Charlus pour exhiber sa virilité, ses condamnations répétées de ce qui à ses yeux paraît « odieusement efféminé » (SG, p.6), ne font partie de son « placard de verre », de son « open secret », que du point de vue du placard lui-même, c’est-à-dire d’un point de vue qui en organise à son insu la mise en spectacle sur fond d’une double méconnaissance : celle du personnage Charlus, qui ignore que ses désirs sexuels sont connus et qui croit même le contraire, persuadé qu’il est qu’il faut en être pour savoir ; celle du narrateur qui partage son secret puisqu’il est possible qu’il en soit sans le savoir. Cette double méconnaissance fonctionne à plein dans la scène de la rencontre entre Charlus et Jupien à laquelle assiste depuis sa cachette le narrateur :
J’allais me déranger de nouveau pour qu’il ne pût m’apercevoir ; je n’en eus ni le temps, ni le besoin. Que vis-je ! face à face, dans cette cour où ils ne s’étaient certainement jamais rencontrés […], le baron ayant soudain largement ouvert ses yeux mi-clos, regardait avec une attention extraordinaire l’ancien giletier sur le seuil de sa boutique, cependant que celui-ci, cloué subitement sur place devant M. de Charlus, enraciné comme une plante, contemplait d’un air émerveillé l’embonpoint du baron vieillissant. Mais, chose plus étonnante encore, l’attitude de M. de Charlus ayant changé, celle de Jupien se mit aussitôt, comme selon les lois d’un art secret, en harmonie avec elle. […] Cette scène n’était, du reste, pas positivement comique, elle était empreinte d’une étrangeté, ou si l’on veut d’un naturel, dont la beauté allait croissant (SG, p.604-605).
Selon Sedgwick, cet extrait cristallise les deux aspects du « placard » proustien : le « spectacle du placard » que trahit (pour Jupien et pour le narrateur-voyeur) l’attitude de Charlus dans cette scène convenue de drague homosexuelle ; et le « point de vue du placard » que viennent occuper mais selon des modalités différentes, deux des protagonistes de la scène : Charlus bien sûr, persuadé qu’il contrôle la situation (qu’il est à l’abri, « in the closet ») et ignorant qu’il est sous le regard du narrateur ; mais aussi, et surtout, le narrateur qui, alors même qu’il pense occuper une position extérieure par rapport à la scène, se laisse néanmoins troubler et séduire par l’équivocité du spectacle auquel il assiste – et dont l’étrangeté première (le caractère « queer » ?) finit par se formuler dans le lexique du « naturel » et de la « beauté ».
A partir de ces queer readings de James et de Proust, on comprend que le type d’analyse proposé par Sedgwick ne se limite pas à savoir si, oui ou non, le narrateur (ou l’auteur) est homosexuel et, si c’est le cas, comment cela se traduit dans ses livres. Il s’agit plutôt d’envisager la littérature comme un laboratoire des identités sexuelles, comme ce lieu privilégié où s’expriment, se dissimulent, se domestiquent aussi, et en tout cas s’expérimentent tous les effets possibles de cette crise définitionnelle de l’homo/hétérosexualité dont Sedgwick fait l’un des enjeux majeurs de notre culture moderne. A ce compte, il est clair que le « queer » sert moins à définir un type d’identité (positive ou négative) qu’il ne désigne une manière de dépérimétrer les identités sexuelles en sortant des assignations commodes et des topologies binaires (in/out) pour entrer dans cette zone trouble, à la limite du dedans et du dehors, où ne cessent de circuler des désirs et des plaisirs multiples et mobiles.
[1] Cet essai a été repris dans Théorie queer et cultures populaires, de Foucault à Cronenberg, trad. fr. M.-H. Bourcier, Paris, La Dispute/Snédit, 2007.
[2] Pour des développements plus complets sur le contexte d’émergence et les enjeux de la « Queer Therory », nous renvoyons d’une part au n° 40/2003 de la revue Rue Descartes (« Queer : repenser les identités »), d’autre part aux analyses d’Elsa Dorlin dans Sexe, genre, sexualités (Paris, PUF, « Philosophies », 2008, notamment chap. 5).
[3] Judith Butler, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité [1990] (trad. fr. C. Kraus, Paris, La Découverte, 2005); Ces corps qui comptent. De la matérialité et des limites discursives du « sexe » [1993] (trad. fr. C. Nordmann, Paris, Amsterdam, 2009).
[4] Judith Butler est ici tributaire de la révision derridienne du « performatif » austinien. Voir notamment Jacques Derrida, « Signature événement contexte » in Marges. De la philosophie, Paris, Minuit, 1972
[5] Eve Kosofsky Sedgwick (Ed.), Novel Gazing. Queer Readings in Fiction, Durham & London, Duke University Press, 1997.
[6] Didier Eribon, Réflexions sur la question gay, Paris, Fayard, 1999, p.84-85.
[7] Dans Queer Critics. La littérature française déshabillée par ses homo-lecteurs (Paris, PUF, « Perspectives critiques », 2002), François Cusset se livre à un pastiche de ce type de lecture qui définit selon lui la pratique universitaire de la « Queer Theory » aux Etats-Unis.
[8] Eve Kosofsky Sedgwick, Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire, New York, Columbia University Press, 1985.
Qu’est-ce que le quotidien ? Il faut bien reconnaître que nous nous posons rarement cette question tant la vie quotidienne constitue la trame irréfléchie de notre expérience commune, à laquelle elle offre une forme de nécessité silencieuse, anonyme et familière. Faire les courses, manger, s’habiller, dormir : autant d’actions que nous accomplissons le plus souvent sans y prêter attention, comme si elles étaient incorporées à notre existence au point qu’elles n’éveillent plus de notre part aucune curiosité mais qu’elles suscitent plutôt l’impression d’une fatalité ordinaire, d’un ordre des choses « allant de soi » à reconstituer chaque jour pour renouveler ce pacte de confiance tacite qui nous permet d’être en paix avec la réalité, voire d’avoir le sentiment trompeur de la dominer, de la maîtriser et d’en contrôler le cours. Or, qu’en est-il exactement de cette vie quotidienne qui forme le fondement impensé de toute vie humaine, et donne à l’existence le visage rassurant de ce qui se déroule selon la régularité rassurante d’un “ordre” habituel, stable et cohérent, pour cette raison même soustrait à toute investigation critique ? Qu’est-ce qui, en d’autres termes, donne à la vie ordinaire cette allure d’une vie “normale” et qu’est-ce qui justifie cette normalité apparente des rituels du quotidien à laquelle l’homme paraît si fortement attaché comme à l’une des conditions absolues de son existence ? Dans la production philosophique récente, ces questions font l’objet de recherches novatrices qui, au-delà de leurs divergences, contribuent selon nous à réactualiser de manière originale le thème d’une “critique de la vie quotidienne”, naguère initié par Henri Lefebvre[1] . En effet, Guillaume le Blanc dans Les maladies de l’homme normal [2] et Bruce Bégout dans La découverte du quotidien [3] explorent chacun à leur manière la signification du quotidien en vue de déterminer quelles sont ses potentialités critiques. Nous voudrions dans les pages qui suivent renouer les fils du débat qui s’engage manifestement entre ces deux ouvrages sur la question essentielle à nos yeux du rapport de l’homme quotidien aux normes qui structurent son expérience et son existence ordinaires. D’où vient en effet que la vie quotidienne passe pour une vie normale, régulière et ordinaire, alors même que la vie humaine ne cesse d’être soumise à l’irrégularité d’événements qui en rompent le cours continu et la confrontent ainsi à ses propres limites ou défaillances, mais aussi, et complémentairement, renforcent l’exigence sourde de son auto-conservation ? La difficulté consiste ici à mettre à distance le caractère d’évidence de la quotidienneté pour faire ressortir la dimension problématique de son apparente normalité. La stabilité et la cohérence de la vie quotidienne ne sont peut-être pas en effet données avec elle mais relèvent plutôt d’une opération de normalisation dont il convient d’élucider les modalités concrètes ainsi que les conséquences pratiques. Or, c’est justement à ce travail d’élucidation que s’attachent, dans des perspectives différentes, les ouvrages de G. le Blanc et de B. Bégout.
L’interrogation sur la “vie ordinaire” que propose le
premier prend place à l’intérieur d’une réflexion plus générale sur le statut et les limites de l’“homme normal”, c’est-à-dire en réalité de l’homme malade de cette normalité à laquelle la
société lui enjoint d’adhérer ou à laquelle il finit par s’attacher de lui-même (en incorporant les normes dans des habitus), pour pouvoir vivre comme tout le monde et ne pas risquer
d’être rejeté dans les marges du système [4]. Or, la vie quotidienne paraît constituer le terrain privilégié de cette normalisation. Celle-ci prend en effet la
forme d’une “prise du pouvoir sur l’ordinaire de la vie”[5] ou encore d’une insinuation du normal dans les moindres parcelles de
l’existence humaine, ainsi rappelée à l’ordre dans toutes ses dimensions et au final assujettie à cet ordre des choses qui fournit le cadre structuré et contraignant au sein duquel elle peut se
déployer comme une existence normale, c’est-à-dire normalisée, aspirant à cette normalité qui ne peut manquer de faire souffrir l’homme ordinaire.
Pourtant, G. le Blanc ne s’en tient pas à cette analyse unilatérale qui tend à faire de la vie ordinaire le réceptacle passif d’une injonction normalisante qui l’envahirait et la reconditionnerait au point d’annuler justement en elle toute dynamique “vitale”. En situant sa réflexion dans le prolongement de celles de Georges Canguilhem (portant notamment sur la distinction entre normalité et normativité du point de vue du vivant[6] ), et de Michel de Certeau (portant sur le thème d’une “invention” de la vie quotidienne[7] ), il cherche plutôt à marquer la tension interne qui traverse la “vie ordinaire”, en tant qu’elle est à la fois ordonnée selon des normes sociales qui en règlent le cours et rappellent à l’ordre le sujet (en produisant des formes de subjectivation qui dépendent de son assujettissement), et vouée au désordre immanent de pratiques vitales (celles du “braconnage”[8], de l’“usinage”[9] ou des “catachrèses”[10]) qui témoignent d’“expériences psychiques inédites”[11] et d’“usages de soi”[12] créateurs : “Ce qui définit la vie ordinaire, c’est ainsi une formidable activité dans les endroits mêmes où l’on pourrait trop rapidement tenir l’homme ordinaire pour le plus passif qui soit”[13] . De ce point de vue, il s’agit bien de réintroduire de la vie, et de la vie humaine, avec ce qu’elle comporte de plasticité et d’inventivité, dans l’ordinaire, ainsi soustrait à la dimension homogénéisante de la pure répétition. A la dualité abstraite d’un flux vital en devenir intensif et d’un quotidien figé dans la banalité et dans l’identité du normal, G. le Blanc oppose la perspective d’une dialectique concrète de la norme et de ses écarts, qui donne forme à une critique de la vie quotidienne, entendue comme l’actualisation permanente de la vitalité propre au quotidien et aux déplacements qu’il implique jusque dans ses rituels les plus réglés en apparence. Par conséquent, le travail des normes dans le quotidien (qui prend la forme de l’assujettissement disciplinaire) se trouve retourné et complété par le travail du/au quotidien dans les normes, “dans le blanc des normes”[14] , qui prend la forme d’une résistance créatrice à “l’identité absurde de la normalité” [15] . Le thème générique d’une “invention du quotidien” renvoie alors aussi bien à l’idée que le quotidien est en lui-même porteur de cette inventivité et de ces décalages infimes qui introduisent du “jeu” dans les normes et les fait ainsi “craquer”[16] , qu’à l’idée que ces micro-décalages produisent et en un sens “inventent” également des “tours psychiques”[17] originaux, contribuant de cette manière à l’émergence de ce que Judith Butler appelle un sujet “tropique”[18] , qui fait retour sur la norme qui l’assujettit et, par ce tropisme, lui impose son “style” singulier : “Le détournement, c’est l’effet du retournement du sujet sur la norme qui le produit et ce détournement marque la possibilité même d’introduire un peu d’air frais dans le jeu des normes. Le détournement, c’est le retournement de la vie psychique sur la norme. C’est cette opération de détournement que j’appelle style. […] Il existe, par conséquent, un pouvoir de singularisation de la norme qui s’opère dans le détournement, dans la déviation”[19] . Une figure stylisée de l’homme normatif est ainsi conquise sur le fond de la normalisation de la vie quotidienne : celle-ci n’est donc pas repliée sur les formes figées d’une normalité que tend à lui imposer la société et que tend à s’imposer l’homme dans son existence ordinaire, mais bien ouverte sur la perspective de sa transformation incessante par le biais de ces “pratiques de l’ordinaire qui sont comme autant de contaminations du réel par le possible”[20] .
L’originalité propre à cette démarche consiste alors à montrer comment la vie quotidienne produit du “soi” sous la forme résiduelle mais active d’une singularité vivante qui se donne moins comme une alternative émancipatrice à l’homme normal que comme cet autre tour psychique qui fait “jouer” les normes instituées dans des pratiques antidisciplinaires[21] qui sont avant tout des pratiques de soi, - manifestant ainsi de manière paradoxale un véritable souci de soi jusque dans l’accomplissement de ces normes.
C’est manifestement dans une tout autre direction et vers une autre forme de critique de la normalité quotidienne que nous entraîne Bruce Bégout dans son dernier livre[22] . En effet, au lieu de mettre au jour la vitalité créatrice d’un soi qui s’affirme en quelque sorte par excès, en trouant le cours ordonné du quotidien, il analyse plutôt le processus de normalisation immanente qui donne à la vie quotidienne la stabilité et la régularité d’après lesquelles justement nous la jugeons “normale”, c’est-à-dire ayant le caractère évident et quasi naturel de ce qui va de soi . L’idée principale défendue ici est que “la normalité ne peut donc être réduite aux simples normes sociales qui cherchent à dicter le cours du monde en prescrivant leurs valeurs”[23] . En d’autres termes, l’invasion et la colonisation de la réalité quotidienne par des procédures normatives contraignantes, à la fois disciplinarisantes et assujettissantes, tendent à occulter le principe même d’une “discipline quotidianisante”[24] , d’un “processus de quotidianisation”[25] qui est au principe même de la constitution d’un monde de la vie quotidienne. Il s’agit par là, dans une perspective génétique et phénoménologique, d’établir les conditions dans lesquelles s’opère de manière passive et anonyme, au sein même de la vie humaine, un travail de familiarisation ou encore de domestication du non-familier, de l’“anormalité primitive du monde”[26] . La vie quotidienne est par conséquent le produit original d’une telle opération de normalisation primaire qui ne procède donc pas du pouvoir ou des ordres sociaux, mais de la vie elle-même, en tant qu’elle cherche à assurer sa propre persévérance par le biais de cette construction d’un monde familier, cohérent et stable, qui nous apparaît d’autant plus normal qu’il parvient à dissimuler ses propres modalités d’institution[27] . Celles-ci renvoient en effet à la dynamique constituante d’une “infra-dialectique inconsciente”[28] du familier et de l’étranger dont l’objectif est justement la normalisation de nos rapports avec “l’étrangeté primitive de l’être-au-monde”[29] , source pathogène d’angoisse et d’incertitude quant à la possibilité même de persévérer dans l’être.
Dans ces conditions, nous voyons qu’en proposant cette analyse de la “proto-normalité de la constitution quotidienne de l’expérience familière”[30] , B. Bégout est conduit à accorder à la notion de “vie quotidienne” un sens assez différent de celui que lui attribue G. le Blanc. Car s’il y a bien quelque chose de vivant dans le quotidien, cette vitalité ne se manifeste pas sur fond d’un système contraignant de normes sociales et historiques qui lui servent de points d’appui commodes pour sa propre créativité et pour l’inventivité psychique de l’homme normal. Elle est bien plutôt cette force formatrice qui conduit le quotidien lui-même à se normaliser, c’est-à-dire à aménager en lui cette stabilité et cette régularité de l’expérience qui nous permet d’avoir confiance en elle : “Ressaisi à partir du processus de familiarisation, le quotidien n’est pas écart et résistance. Il n’est même pas créativité personnelle. La formation de la quotidienneté appartient en effet à une genèse passive et anonyme où l’activité rusée d’une conscience faible n’a aucune place”[31] . Mais alors, si la vie quotidienne n’est, comme semble le penser B. Bégout, que l’effet involontaire d’une construction essentiellement passive, est-ce qu’elle ne se trouve pas par là même destituée des potentialités critiques que lui accordait G. le Blanc lorsqu’il y voyait l’espace privilégié d’un jeu réglé de la vie dans les normes et d’une invention de soi dans ce jeu ? Certainement, si l’on considère que la “critique de la vie quotidienne” procède de la résistance antidisciplinaire d’un sujet normatif, créateur de ses propres normes d’existence. Toutefois, sans s’aligner sur cette position théorique qui fonde la compréhension du quotidien sur l’opposition active de la normalité et de l’écart, B. Bégout refuse également de ramener les opérations de familiarisation passive inhérentes à la constitution d’un monde quotidien à la dimension d’un assujettissement unilatéral de l’homme ordinaire aux impératifs aliénants de l’ordre social : “La vie quotidienne elle-même renferme une passivité qui n’est pas le symptôme de son assujettissement aux dispositifs mécaniques des pouvoirs sociaux. La genèse passive de la familiarisation est tout, sauf aliénée”[32] . B. Bégout laisse ainsi entendre qu’il existe une dimension proprement critique de la vie quotidienne qui ne prend pas appui sur sa supposée réactivité par rapport aux normes sociales et sur les opérations de stylisation et de subjectivation qui l’animent, mais bien sur sa constitution passive et impersonnelle. A quoi tient alors la valeur critique paradoxale de l’“autodiscipline quotidienne”[33] ?
D’abord, négativement, à ce que cette puissance d’autonormalisation à laquelle se trouve soumise notre expérience ne conduit pas (du moins pas nécessairement) à son appauvrissement et aux formes stérilisantes de la routine ou du conformisme[34] . Reprenant à son compte les analyses de G. le Blanc sur les “maladies de l’homme normal”, B. Bégout montre en effet que “le processus de quotidianisation peut engendrer une certaine forme de pathologie de la familiarisation”[35] qui tient à ce que les valeurs du familier et de l’identique l’emportent absolument sur celles de l’ouverture à l’étrangeté et à la différence : si cette “fixation unique sur le familier”[36] est subie, le quotidien sombre dans l’indifférence de la routine ; mais cette vie routinière elle-même peut être assumée et valorisée pour elle-même sous la forme d’un conformisme qui désigne le repli délibéré de l’homme ordinaire sur les valeurs familières de sa communauté. Pourtant, ces dérives pathologiques de la quotidianisation permettent aussi a contrario de mettre à jour le versant positif (et, comme on va le voir, la dimension autocritique) du processus de normalisation qui la caractérise. Car un tel processus ne s’opère pas exclusivement en direction de la “perpétuation statique du familier”[37] . Du moins la familiarisation de notre expérience repose-t-elle sur une tension en principe non résolue entre “une forte tendance à l’implantation [de la vie quotidienne] dans des gestes identiques et répétitifs, dont le caractère stéréotypique n’est pas automatiquement désavoué mais, au contraire, bien souvent recherché et prisé, et l’attrait soudain pour la nouveauté, le changement, la variété, dans lesquels elle éprouve, sur un mode ambigu d’attirance et de répulsion, ce que l’on pourrait nommer le pressentiment obscur du possible”[38] . C’est cette double aspiration contradictoire à l’identique et au différent qui caractérise en propre la vie quotidienne et qui constitue alors sa dimension critique. Car la dynamique de normalisation qui est à l’œuvre en elle permet à l’homme quotidien de résister aussi bien à la routinisation intégrale de ses conduites qu’à sa soumission unilatérale aux normes sociales. Une telle résistance procède donc moins d’une dialectique de la norme et de l’écart, qui fait jouer l’inventivité du quotidien lui-même contre les procédures normalisatrices qui tendent à l’investir, que de cette « synchronicité dialectisée »[39] qui met aux prises, à un niveau infrapolitique, la normalisation quotidianisante (comme tendance au Même) et la « vie » quotidienne elle-même (comme ouverture incessante à l’Autre et remise en cause possible des ordres établis). C’est cette capacité propre au quotidien à s’adapter et à trouver un équilibre, toujours provisoire, entre le familier (où il menace de dégénérer en routine ou en conformisme) et l’étranger (qui l’expose à l’incertitude de nouvelles rencontres) qui conduit B. Bégout à avancer finalement l’idée d’une « prudence quotidienne »[40] , à entendre avant tout comme la prudence du quotidien lui-même, où celui-ci trouve les ressources de sa propre critique immanente. Au lieu de consister à créer du « soi » dans le blanc des normes, cette critique consiste donc plutôt, pour la vie quotidienne, à « s’arranger tous les jours avec ses propres contradictions »[41] , c’est-à-dire à trouver le juste milieu entre les excès de la familiarisation et ceux de l’ouverture immodérée à la contingence de l’expérience.
Si donc une critique de la vie quotidienne a encore un sens ici, celui-ci est moins à chercher dans les figures de l’écart transgressif et de la réappropriation stylisée de soi par soi dans le jeu des normes, que dans la forme positivement « médiocre »[42] d’une dialectisation continue du familier et de l’étranger, de l’homogène et de l’hétérogène. Il reste que, malgré cette différence qui tend à les opposer, les approches que nous avons rapidement présentées tendent l’une comme l’autre à envisager le quotidien avant tout comme le lieu privilégié d’une transformation, qu’il s’agisse de la transformation de l’homme normal en homme normatif (selon l’opération tropologique du retournement du soi sur la norme), ou de la transformation incessante de l’hétérogène en homogène et de l’homogène en hétérogène (selon le processus de l’infra-dialectique du familier et de l’étranger). Et au final, c’est bien cette capacité auto-transformatrice du quotidien qui le rend insaisissable et constitue par là même sa valeur critique : car le monde quotidien reste à vivre au jour le jour, avec son équivocité constitutive, - celle d’un monde où il est à fois difficile de devenir « soi » et tentant de se replier sur le confort rassurant d’un « chez soi » familier.
[1]Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, Paris, L’Arche, 1958.
[2]Guillaume le Blanc, Les maladies de l’homme normal, Bègles, Éditions du Passant, “Poches de résistance”, 2004 (ensuite cité MHN).
[3]Bruce Bégout, La découverte du quotidien, Paris, Allia, 2005 (ensuite cité DQ).
[4]Pour une présentation détaillée des enjeux du livre de G. le Blanc, voir la présentation de Katia Genel ainsi que les remarques de Pierre Macherey au sujet du concept de “vie ordinaire” sur le site de l’U.M.R. “Savoirs et Textes” de l’Université Lille 3 (http://www.univ-lille3.fr/set/sem/genelleblanc.html et http://www.univ-lille3.fr/set/sem/macherey07042004.html ). Notre analyse prendra appui pour l’essentiel sur le chapitre XI des Maladies de l’homme normal, consacré précisément au thème de “La vie ordinaire”.
[5]Michel Foucault, “La vie des hommes infâmes”, in Dits et écrits, tome 3 (1976-1979), Paris, Gallimard, “Bibliothèque des sciences humaines”, 1994, texte n°198 [1977], p.245 (cité par B. Bégout, in DQ, p.555). Il faut préciser toutefois que, dans la perspective de Foucault, l’entrecroisement de “toute une chaîne politique […] avec la trame du quotidien” (p.247) correspond à un moment précis de l’“histoire des mécanismes de pouvoir” (Ibidem), celui qui, à la fin du XVIIe siècle, conduit, dans le sillage du régime monarchique, à une nouvelle “mise en discours du quotidien” (p.245) qui engage également un nouveau mode d’être de la littérature (pp.251-253). G. le Blanc a bien analysé ce dernier point dans son intervention sur “L’écriture de l’ordinaire” lors de la journée d’études “Michel Foucault. Travaux actuels” qui s’est tenue à l’E.N.S. en mars 2005 (il est possible d’écouter cette conférence à l’adresse internet suivante : http://www.diffusion.ens.fr/audio/2005_03_12_leblanc.mp3 ).
[6]Voir à ce sujet les analyses du Normal et le pathologique (Paris, PUF, “Quadrige”, 1966) proposées par G. le Blanc dans Canguilhem et les normes, Paris, PUF, “Philosophies”, 1998, notamment, pp.52-58.
[7]Michel de Certeau, L’invention du quotidien, 1. Arts de faire, Paris, U.G.E., 1980 ; rééd. Gallimard, 1990.
[8] MHN, p.180 (ce terme est repris à Michel de Certeau).
[9] Ibid., p.174 (ce terme est emprunté à Deleuze et Guattari).
[10] Ibid., p.180 (ce terme, d’origine linguistique, est utilisé en psychologie du travail, notamment par Yves Clot).
[11] Ibid., p.165.
[12] Ibid., p.175.
[13] Ibid., p.177.
[14] Ibid., p.175.
[15]Ibid., p.167. Notons que c’est dans l’activité de travail que cette tactique de détournement des normes prescriptives par les travailleurs eux-mêmes est particulièrement mise en valeur (MNH, chapitre VI : “Les règles du travail”) : “Jamais un ouvrier ne reste devant sa machine en pensant : je fais ce qu’on me dit” (MNH, p.93 ; il s’agit du propos d’un ajusteur, cité par Yves Schwartz dans Expérience et connaissance du travail, Paris, Éditions Sociales, “Terrains”, 1988, p.21). Voir à ce sujet les analyses initiées par G. le Blanc dans Canguilhem et les normes (pp.98-101) et développées dans La vie humaine : anthropologie et biologie chez Georges Canguilhem, Paris, PUF, “Pratiques théoriques”, 2002 (notamment chapitre V : “La création sociale”).
[16] MHN., p.15.
[17] Ibid., p.171.
[18]Judith Butler, La vie psychique du pouvoir, Paris, Léo Scheer, 2002, “Introduction”, notamment, pp.24-26 (pour la présentation générale de cette “inauguration tropologique du sujet”). Voir aussi sur cette question l’article de G. le Blanc, “Être assujetti : Althusser, Foucault, Butler”, in Actuel Marx, n°36, “Marx et Foucault”, 2004, pp.45-62.
[19] Ibid., p.172.
[20] Ibid., p.211.
[21] G. le Blanc reprend cette notion d’“antidiscipline” à Michel de Certeau qui la forge en référence aux analyses de Foucault sur le pouvoir disciplinaire (MHN, p.177 ; voir L’invention du quotidien, p.14).
[22]Nous limiterons notre analyse aux réflexions proposées par B. Bégout dans les deux derniers paragraphes de son livre : “Normalité et normativité quotidiennes” et “Résistance, invention et prudence” (DQ, pp.537sq).
[23] DQ, p.549.
[24] Ibid., p.553. B. Bégout parle un peu plus loin d’une “autodiscipline quotidienne” (p.556) qui s’oppose clairement à la perspective d’une “antidiscipline” produite par la créativité quotidienne selon de Certeau.
[25] Ce processus est analysé pour lui-même dans le chapitre 2 de la troisième partie du livre de B. Bégout (DQ, pp.312sq).
[26] Ibid., p.540.
[27]C’est ce que B. Bégout nomme le “mensonge quotidien” (voir l’analyse qu’il en propose dans DQ, pp.336sq).
[28] Ibid., p.557.
[29] Ibid., p.314.
[30] Ibid., p.549.
[31] Ibid., pp.569-570.
[32] Ibid., p.570.
[33] Ibid., p.566.
[34]Voir les analyses de la routine et du conformisme in DQ, pp.559-563.
[35] Ibid., p.557.
[36] Ibid., p.565.
[37] Ibid., p.560.
[38] Ibid., pp.563-564.
[39] Ibid., p.565.
[40] Ibid., p.581.
[41] Ibid., p.585.
[42] “La médiocrité du quotidien consiste tout entière dans sa médiété : être le milieu et la médiation des contraires sans privilégier l’un ou l’autre. […] Cette médiocrité n’est plus à entendre comme la platitude ou la banalité, ce qui est le plus bas, mais comme ce qui est le plus haut, la combinaison dialectique du familier et de l’étranger” (Ibid., p.583).